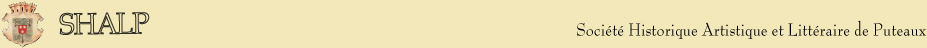

Talleyrand

Robespierre
Littérature > Publications > Nouvelles > La réunion du diable et de l’Incorruptible
![]()
La réunion du diable et de l'Incorruptible
par Laurent Blanchet
Décor : un petit salon de style XVIIIe siècle : une porte et des murs lambrissés, une commode, un buffet sur lequel se trouve un service à liqueur, une bibliothèque, un grand miroir ovale, un lustre dont la lumière éclaire deux fauteuils autour d’une table. Dans le coin opposé à la porte, et dans un clair-obscur se tient un homme, les bras croisés derrière le dos. Il semble attendre.
Talleyrand (entre dans la pièce) : Hé bien ma foi ! On dirait que je suis arrivé… Il ne me reste plus qu’à savoir où… (un temps) Voilà un endroit bien singulier pour le séjour des morts ; je m’étais préparé à tout sauf à cela… Un petit salon sans prétention, agrémenté d’un mobilier quelconque et passe-partout, un éclairage sobre, une décoration sans apprêts… Et la porte… (il tourne la poignée) Verrouillée naturellement… Je crois que je n’ai guère le choix. (un temps ; il s’assoit sur un fauteuil) Et puis après tout, cela eût pu être pire. Cet austère boudoir n’est pas si terrible en définitive, si seulement je n’étais pas… (il aperçoit quelqu’un)…seul.
Robespierre : Poursuivez Talleyrand, je vous écoutais depuis le début et j’attendais le moment où vous alliez révéler vos sombres forfaits.
Talleyrand : Puis-je connaître l’identité de celui qui m’appelle par mon nom, sans le faire précéder de mes titres ?
Robespierre : Maximilien Robespierre, l’ennemi des titres autant que des aristocrates qui les portent et s’en glorifient.
Talleyrand : Robespierre ? Il y a bien longtemps que ce nom n’a résonné à mes oreilles… C’est à peine si je me souviens de vous, et encore moins si je vous connais… Votre nom m’évoque le souvenir d’une régime troublé, auquel je me suis soustrais avant que d’en être la victime… Il est d’ailleurs singulier que nous nous retrouvions tous les deux dans l’au-delà, attendu que nous sommes presque des étrangers l’un pour l’autre… (un temps) Mais dites-moi, avez-vous la moindre idée de notre présence ici et de la nature de ce lieu ?
Robespierre : En doutez-vous encore ? Cette interrogation serait plus légitime dans ma bouche que dans la vôtre, mais elle est révélatrice du criminel impénitent. Allons ! Réfléchissez un instant : où quelqu’un qui toute sa vie a conspiré, trafiqué, intrigué, menti, trahi, flagorné, courtisé, peut-il espérer finir après la mort ?
Talleyrand : Mais voyons, c’est impossible, j’ai pourtant fait tout ce qu’il fallait, j’ai respecté les procédures…
Robespierre : Les derniers sacrements sont inefficaces si le pêcheur qui les demande ne fait pas sincèrement acte de contrition. A quoi sert d’être scrupuleux dans les formes si le cœur est toujours corrompu ? Pensiez-vous avoir affaire à un Dieu formaliste ? Vous avez fait erreur : Dieu n’écoute que les intentions du cœur, et celles du vôtre étaient impures au moment du trépas.
Talleyrand : Mais comment diable savez-vous tout cela sur moi ? Qui vous a renseigné ?
Robespierre : Apprenez qu’en ce lieu, la vérité règne en maîtresse absolue. On ne peut travestir ses pensées, et je lis dans les vôtres comme dans un livre ouvert. Il n’y a plus de place pour les intrigues et les artifices désormais.
Talleyrand : Alors vous devez vous estimez heureux : cet endroit est fait pour vous.
Robespierre : Non, hélas. Que me sert de pénétrer le secret des âmes si je ne puis le dénoncer à la face du monde. En vérité, il n’y a pas de supplice plus atroce.
Talleyrand : Et… Savez d’autres choses à mon égard ?
Robespierre : Je sais tout. Et si cette rencontre s’était déroulée de notre vivant, je vous aurais voué aux gémonies. Seulement, il n’est plus temps. Je ne vous dirais qu’une chose : je vous haïssais déjà sous la Révolution parce que je soupçonnais vos crimes ; maintenant que j’en connais l’étendue, je vous hais plus que jamais.
Talleyrand : Robespierre, vous avez un défaut et une qualité : votre défaut c’est que vous soupçonnez beaucoup de monde ; votre qualité, c’est que vos soupçons s’avèrent toujours exacts.
Robespierre : De mon point de vue, ça fait donc deux qualités.
Talleyrand : Pardon, j’oubliais un deuxième défaut : vous êtes totalement dépourvu de tout sens de l’humour.
Robespierre : Je n’ai pas pour coutume de plaisanter avec mes ennemis.
Talleyrand : Oui, je viens de m’en apercevoir. Encore que ce point de vue est discutable : si vous ne savez pas rire de vous-même, vous savez fort bien à l’occasion, persifler vos ennemis. Seulement, votre humour est tel votre voix : aigrelet et glaçant. Quoi qu’il en soit, il n’était pas dans mon intention de vous offenser par mes saillies.
Robespierre : C’est trop tard, le mal est fait.
Talleyrand : Vraiment ? Voilà qui est fâcheux. Comment puis-je espérer me faire pardonner ? Tenez, je vous invite à un brin de causette, voulez-vous ?
Robespierre : N’y comptez pas.
Talleyrand : Allons, ne faites pas l’obstiné. Nous partageons peut-être plus de points communs que vous le croyez… (un temps) Si mon esprit vous est transparent, sachez que la réciproque est vraie, et je commence à voir clair en vous. La diplomatie m’a appris que pour commencer des négociations, il faut toujours partir d’un terrain d’entente. Voyons…Essayons de voir ce qui nous rassemble…Tenez, par exemple, nous aimons les chiens vous et moi…
Robespierre : Vous préférez les hommes.
Talleyrand : Nous sommes très friands de café…
Robespierre : Ma seule gourmandise ; votre ultime vice.
Talleyrand : Nous avons voulu le bonheur de la France…
Robespierre : A condition qu’il fît le vôtre.
Talleyrand : Nous portons une particule…
Robespierre : J’ai renié la mienne ; encore n’était-elle pas nobiliaire.
Talleyrand : Nous portons perruques et bas de soie, tout coquets que nous sommes…
Robespierre : Vous l’êtes pour complaire à vos maîtresses ; je ne le suis que pour m’agréer moi-même.
Talleyrand : Nous avons abandonné nos amis…
Robespierre : Vous avez trahi les vôtres pour de l’or et des femmes.
Talleyrand : Cela vaut mieux que de les avoir guillotinés…
Robespierre : Il est plus noble de sacrifier ses amis pour le bien public que de les friponner pour son intérêt particulier.
Talleyrand : A votre guise ! Il n’empêche qu’à tout prendre, vos amis auraient dû être les miens, au moins auraient-ils conservé leur vie, à défaut de leur patrimoine et de leur femme.
Robespierre : Je pense tout le contraire. Il vaut mieux porter ses idées jusqu’à la mort plutôt que d’abdiquer celles qu’on a pour une misérable rallonge de vie passée dans l’opprobre et la honte. Mais ces propos ne m’étonnent guère dans votre bouche : ils sont ceux d’un fourbe doué d’un lâche digne de ses amis, non moins fourbes et non moins lâches que lui. Par certains côtés, vos amis vous ressemblent, mais jamais leur perfidie n’égala la vôtre, sinon vous ne les auriez pas circonvenus.
Talleyrand : Voilà qui est parlé ! Si je suis votre raisonnement, j’en conclus que, tout comme pour mes amis, les vôtres vous ressemblent : ils sont aussi purs et vertueux que vous, n’est-ce pas ?
Robespierre : Je n’ai jamais dit cela ; si tel avait été le cas, croyez-vous que je les aurais supprimés ?
Talleyrand : Mais tout de même, vous ne pouvez nier qu’ils vous ont fait honneur en montant à l’échafaud par fidélité à leurs idéaux, n’est-ce pas ?
Robespierre : Dans ces moments-là, je dois reconnaître que je n’étais pas déçu de les avoir eu naguère pour amis.
Talleyrand : Et tout comme je surclasse mes amis en vices, vous dépassez les vôtres en vertus, naturellement ! Heureuse comparaison ! Logique implacable ! Habile procédé pour me noircir ! La noblesse de vos amis témoigne en votre faveur ; la vilénie des miens m’accable. Et dire que c’est avec de semblables spéciosités que vous avez subjugué la populace…
Robespierre : Je croyais que vous vouliez entamer des pourparlers avec moi ; sachez que vous vous y prenez très mal, surtout pour un diplomate de votre réputation.
Talleyrand : Vous avez raison, je me suis quelque peu emporté ; ce n’est pas dans mon tempérament ni dans mes habitudes. Mais reconnaissez que vous n’êtes pas d’un abord très facile. Quoi qu’il en soit, que ma brève incartade ne vous rebute point : il est dans notre intérêt à tous deux de nous entendre, et vous verrez que nous ne tarderons pas à nous apprécier… Où en étais-je ? Ah oui, les points communs ! Savez-vous que même sous la Révolution – tout au moins, à ses débuts – nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises…
Robespierre : Cela m’étonnerait.
Talleyrand : Nous étions députés aux Etats Généraux…
Robespierre : Vous, au sein du clergé ; moi, du Tiers Etat.
Talleyrand : Nous avons fait partie de l’Assemblée nationale…
Robespierre : Vous ne l’avez rejointe que le 26 juillet 1789, soit un jour seulement avant que le roi ne la sanctionnât. Pour ma part, j’eus l’insigne honneur d’en faire partie, depuis sa naissance jusqu’à sa reconnaissance. Et le 20 juin 1789, je prêtai le serment du jeu de paume, le seul qui manquait à votre carrière de parjure ; le seul que vous ne pourrez jamais vous glorifier d’avoir violé. C’est peut-être la raison pour laquelle celui-ci a été tenu d’ailleurs.
Talleyrand (rires) : Voyons, vous surestimez mes capacités de nuisance. Je veux bien reconnaître que mes actions ont pu avoir quelque influence sur le cours des évènements, mais là tout de même, vous me faites trop d’honneur ! Et puis, à l’époque, je n’étais pas encore au niveau d’empire que vous me supposez – et auquel je suis parvenu par la suite. De surcroît, quand j’aurais eu les moyens de corrompre la totalité des députés de l’Assemblée nationale, il m’eût été impossible de le faire, car j’en aurais été empêché par des hommes tels que vous, à propos de qui Mirabeau a pu dire : « On ne peut acheter cet homme, il n’a aucun besoin ». Alors certes, je n’ai pas prêté le serment du jeu de paume, et effectivement, celui-ci a été tenu. Mais qu’ais-je à voir avec cela ? Je n’ai rien fait qui fût favorable ou préjudiciable à son accomplissement. (un temps) Quoique… Par certains côtés, on peut considérer que ma contribution ne fut pas totalement nulle : est-il besoin de vous rappeler que j’ai fait partie de la Constituante, et qu’à ce titre, j’ai concouru à l’élaboration de la constitution, tout comme vous ? Ainsi, sans avoir prêté serment, j’ai tenu parole.
Robespierre (ironique) : Je n’aurais pas mieux dit : voilà une formule dont l’équivocité ne vous messied point. Il est vrai que l’absence de jurement reste le moyen le plus infaillible de s’assurer de votre parole : on n’est jamais aussi certain que Talleyrand ment que quand il prête serment. Vous avez trahi l’Ancien Régime, le Directoire, le Consulat, l’Empire, et la Restauration… Seule la Révolution vous a éventé et prévenu.
Talleyrand : Oui, c’est le seul régime qui ait jamais juré ma perte : c’est dire s’il était inconséquent. Attendu que « je porte malheur aux gouvernements qui me négligent », combien ne suis-je pas plus funeste aux régimes qui me persécutent !
Robespierre : Les régimes vertueux ont le devoir de purger les éléments vicieux qui se trouvent en leur sein et qui les menacent. En vous éliminant, vous et tant d’autres, la Révolution a démontré que le seul principe qui l’inspirait était la vertu.
Talleyrand : Mais à quel prix ? Qu’est-il advenu de ce régime ? Il s’est donné la mort, après l’avoir donné à tous ses promoteurs, dont vous fûtes probablement le dernier. Tous ceux qui ont juré ma perte sous la Révolution ont péri par elle… (un temps) Mais passons sur l’Assemblée nationale. Il n’en demeure pas moins, comme je le rappelais à l’instant, que nous avons siégé ensemble à la Constituante…
Robespierre : Vous à droite ; moi à gauche.
Talleyrand : Nous y avons défendu la cause des Juifs et celle des Noirs…
Robespierre : Vous par opportunisme ; moi par idéal.
Talleyrand : Nous avons eu des connaissances communes : Mirabeau, Danton…
Robespierre : Et quelles connaissances ! Mirabeau vous a acheté ; vous avez acheté Danton : le premier avait besoin de vous pour s’entendre avec la cour ; vous aviez besoin du second pour vous réfugier en Angleterre. Quant à moi, j’ai condamné leur vénalité en faisant exhumer l’un et inhumer l’autre. Que ne vous ai-je dénoncé et condamné à votre tour lorsqu’il était encore temps ! J’aurais épargné à la France et à toute l’Europe quarante années de prévarications et d’intrigues !
Talleyrand : Vous ne m’avez pas dénoncé nommément, certes, mais vous le fîtes indirectement, lorsqu’en 1791, vous attaquâtes les pétitionnaires du directoire du département de Paris, dont je faisais partie.
Robespierre : Et pour cause, vous et vos amis défendiez le veto du roi contre le décret sur les prêtres réfractaires. Voilà que le plus cynique et le plus dissolu des évêques de France se pose en défenseur de la tradition de l’Eglise. A-t-on jamais vu pareille tartufferie ? A l’époque, je ne voyais en vous qu’un partisan de la contre-révolution parmi tant d’autres. Ce n’était pas Robespierre qui attaquait Talleyrand, c’était le club des Jacobins qui combattait celui des Feuillants.
Talleyrand : Oui, et déjà, vous étiez redouté aussi bien par mes amis politiques que par les vôtres.
Robespierre : Talleyrand, savez-vous que des hommes tels que vous ont rampé par centaines devant moi, postés devant mon logis, guettant le moindre signe de clémence qui ne vînt jamais ? J’ai débarrassé la terre de fripons aussi méprisables que vous, mais assurément moins lâches. Si vous étiez resté en France quelques semaines de plus, je ne vous aurais pas manqué.
Talleyrand : Je n’en doute pas. A l’époque, je dois reconnaître que je vous craignais, et si vous étiez resté le maître de la France par la suite, j’avoue que j’eusse été bien embarrassé d’avoir à être votre ministre des Affaires étrangères, comme je le fus pour Bonaparte ; car alors, il eût été absolument impossible de vous fléchir. Et je ne redoute rien tant qu’un maître inflexible. Bonaparte courroucé contre moi aurait pu m’éliminer mais il ne l’a pas fait, car je suis parvenu à infléchir sa colère. En revanche, je veux bien croire que vous n’auriez pas hésité un instant : vous êtes trop consciencieux pour vous montrer indulgent.
Robespierre : Votre raisonnement serait juste si j’avais seulement aspiré à la tyrannie.
Talleyrand : Cela est vrai : vous n’avez pas aspiré à la tyrannie, vous n’avez fait que l’établir.
Robespierre : Vous vous méprenez : j’ai « organisé le despotisme de la liberté pour écraser le despotisme des rois. »
Talleyrand : Et quelle est la différence entre les deux, sinon une différence de mots ? Avouez que la nuance est subtile.
Robespierre : Nullement ; elle est considérable : entre les deux, il y a une révolution.
Talleyrand : Encore des formules incantatoires ! Aussi puissantes sur les esprits que vaines dans les faits…
Robespierre : Détrompez-vous ! Sous la Révolution, de telles formules avaient force exécutoire. Desmoulins a fait le 14 juillet en ne prononçant que cinq mots : « la saint Barthélemy des patriotes ». Par mes discours, j’ai concouru à faire le 10 août ; par les siens, Marat a précipité les massacres de septembre. Là où vos révolutions de palais vous ont coûté des millions, il ne nous a fallu que des mots pour faire les nôtres ; encore s’agissait-il de révolutions populaires, et partant légitimes.
Talleyrand : Nous y voilà ! Vous invoquez le peuple à présent. Le mot magique est prononcé ! Avec lui, vous en êtes arrivés à justifier les pires excès… Le peuple, c’est la légitimité sur laquelle on s’appuie quand on n’en a pas d’autres…
Robespierre : Et de quelle autre légitimité parlez-vous ? De celle du sang ? De celle de la naissance ? De celle de la fortune ? Vos légitimités ne sont en vérité que des privilèges ; les privilèges sont l’expression de l’injustice ; et l’injustice résulte du crime. Vos légitimités sont donc criminelles.
Talleyrand : Toujours cette rhétorique syllogistique à faire trembler les morts… Je reconnais bien là votre verbe. Et je comprends mieux l’effroi que vous avez inspiré à vos ennemis. Votre raisonnement, bien que captieux, est néanmoins imparable ; qui essaie de le renverser ne fait que s’enlacer dans ses rets. En ce qui me concerne, j’ai bien compris que je ne pourrais pas rivaliser avec vous sur ce terrain. Aussi, préféré-je ne pas poursuivre cette dispute, où je sais que je suis perdu d’avance…
Robespierre : Votre abandon vous accuse : seul le coupable cherche à fuir la lumière de la vérité.
Talleyrand : Vous pouvez toujours continuer, je ne me sens absolument pas concerné par vos élucubrations.
Robespierre : Pourtant vous avez bien des crimes à vous reprochez. Mais je sens qu’il en est un qui vous pèse particulièrement sur la conscience, si tant est que vous en ayez jamais eu une. Un crime gratuit qui entache votre honneur de gentilhomme déjà bien terni… Un crime d’autant plus abject qu’il implique un de vos pairs, d’autant plus cruel qu’il touche un homme dans la fleur de l’âge, enfin, d’autant plus injuste qu’il frappe un innocent… Il pourrait bien s’agir…
Talleyrand : Assez ! Qu’insinuez-vous ? Ne pouvez-vous donc pas avoir le courage de vos opinions ? Pourquoi ne pas m’imputer franchement l’assassinat du duc d’Enghien, puisque c’est là où vous voulez en venir ?
Robespierre : Je ne vous ai pas accusé. Malheur à qui se dénonce !
Talleyrand : Las ! Robespierre, voulez-vous bien cessez de me tourmenter ! Je vous ai dit à l’instant que j’abandonnais la dispute ; je ne suis pas de taille… A l’opposé de vous, je ne subjugue pas mes adversaires par la perversité de mon raisonnement, mais plutôt par celle de ma séduction.
Robespierre : Ce que vous appelez séduction n’est rien d’autre que courtisanerie, flagornerie et corruption…
Talleyrand : Eh quoi ? Qu’est-ce que cela change ? D’ailleurs, à propos de corruption, j’aperçois quelque digestif qui permettrait de nous mettre plus à notre aise. Allons, venez et dégustons ensemble un ou deux verres, et, de grâce, changeons de sujet…
Robespierre : Hors de question.
Talleyrand (soupire) : Alors poursuivons l’explication, mais un verre à la main…
Robespierre : Je regrette, je dois décliner votre invitation.
Talleyrand : Et pourquoi ? Vous avez tort de vous priver… Vous n’allez pas vous mortifier jusqu’en enfer, vous y joueriez un rôle à contre-emploi. Et puis, à quoi cela servirait-il ? Nous sommes déjà damnés. En outre, vos biographes ne seront pas là pour vous voir succomber : pour eux, vous incarnerez à jamais la figure de « l’Incorruptible », irréductible aux plaisirs de la chair et de la bonne chère.
Robespierre : Si vous croyez que j’ai réglé ma conduite en fonction des jugements de mes contemporains et de ceux de la postérité, vous vous méprenez.
Talleyrand : Ah bon ? Pourtant, il semble que vous avez tiré une certaine satisfaction à jouer le rôle de l’Incorruptible. Reconnaissez que votre vertu n’était que l’expression de votre orgueil : ne pouvant dépasser les autres hommes par la naissance ou la richesse, vous avez résolu, d’assez bonne heure, de les surclasser par votre conduite irréprochable. Face à une élite débauchée et discréditée, vous avez su opposer votre indigence et votre vertu. Si ces mêmes élites s’étaient montrées aussi vertueuses que vous, auriez-vous été capables de sombrer dans le vice, pour vous en distinguer ?
Robespierre : Vous me faites la morale sur mon orgueil ? C’est un comble ! N’est-ce pas vous qui avez dit : « Je veux que pendant des siècles, on continue à discuter sur ce que j’ai été, ce que j’ai pensé, ce que j’ai voulu » ?
Talleyrand : Aussi vrai que les derniers mots du dernier discours que vous avez prononcé : « Je vous laisse ma mémoire, elle vous sera chère et vous la défendrez. » Allons, lequel d’entre nous deux n’est pas pénétré d’amour-propre ? Je crois que sur cet article, nous sommes très proches…Ca nous fait au moins un point commun. Nous aurions pu commencer par là pour entamer les négociations… Seulement, il est un peu tard maintenant. Et puis nous n’avons pas respecté les bienséances…
Robespierre : « La bienséance n’est que le masque du vice »
Talleyrand : Voilà que vous citez Rousseau à présent ! Cela faisait longtemps… Toujours aussi imbu des idées du « divin Jean-Jacques », à ce que je vois… Est-il seulement possible que vous puissiez vous passer de lui un instant ? Ne pouvez-vous pas penser par vous-même ? Pourquoi un tel acharnement à vouloir se rattacher à un système, quand les circonstances viennent vous en démontrer la fausseté ? Plutôt que d’adapter votre pensée à la réalité, vous avez façonné la réalité à partir de votre pensée. Je n’en reviens toujours pas… Les ennemis qui jusque-là peuplaient votre cerveau malade, sont devenus réalité le jour où vous avez convaincu la France de leur existence. C’est vous qui les avez suscité en vérité, c’est vous qui leur avez donné vie à force de dénoncer complots sur complots, à force de crier à la trahison, à force d’attiser la peur et de semer la haine. Votre définition de la situation, pour imaginaire qu’elle ait été, n’en fut pas moins réelle dans ses conséquences. Vous avez transformé, par vos discours inexorables et votre logique manichéenne, de simples contradicteurs en farouches calomniateurs ; vous avez incité les faibles à vous craindre ; vous avez provoqué l’hostilité des tièdes ; vous avez poussé même vos anciens amis à vous trahir. En voulant prévenir les traîtres, les conspirateurs, les intrigants et les factieux, vous n’avez fait que les multiplier. « La sensibilité qui gémit presque exclusivement pour les ennemis de la liberté m’est suspecte » ; « Je dis que quiconque tremble en ce moment est coupable » ; « quand on aime faiblement la patrie, on est pas loin de la trahir » ; « Tout le monde est coupable, quand la patrie est malheureuse » ; « Sont déclarés suspects tous ceux qui, n’ayant rien fait contre la liberté, n’ont cependant rien fait pour elle » ; pensiez-vous qu’avec de telles formules, vous et vos émules pouviez gagner les cœurs ? Il n’est pas surprenant que des raisonnements aussi pervers aient fini par causer votre perte. Et comment aurait-il pu en être autrement ? Votre seule occupation au pouvoir consistait à vous créer des ennemis pour les éliminer par la suite, avant d’en recréer de nouveaux. Vous avez été votre propre fossoyeur… A la réflexion, il apparaît que tout cela ne pouvait se finir autrement que par un 9 thermidor : devant une Convention docile, deux fois purgée par vous, saignée de ses éléments les plus courageux, mais non des plus lâches et des plus serviles, vous renouvelâtes vos menaces, d’autant plus terrifiantes qu’elles étaient universelles, et d’autant moins bien perçues qu’elles semblaient injustifiées aux yeux de tous. Ceux qui vous ont perdu ne demandaient qu’à vous suivre, à condition d’avoir la vie sauve ; lorsqu’ils comprirent que même la vie leur serait refusée, alors ils devinrent vos ennemis les plus acharnés. La coalition des lâches a éliminé les derniers braves de la Convention, ceux-là mêmes qui l’avaient purgée de tous les autres : Saint-Just, Couthon, Lebas, votre frère et vous-même…Les cinq derniers conventionnels prêts à se sacrifier pour leurs idéaux… Grâce à vos soins, Bonaparte a hérité d’un Sénat bien discipliné, que je n’eus aucun mal, le moment venu, à rallier à la cause des Bourbons…
Robespierre : Le trait de mon caractère que vous décriez n’est rien d’autre que la sincérité de mes convictions. Pour être cru, il faut être crédible, et pour être crédible, il faut être convaincu ; or, qui plus que moi l’était sous la Révolution ? Grâce à mes convictions, j’ai pu imposer ma définition du monde, et partant, accéder au pouvoir suprême. Car, sachez-le : contrairement à ce que vous avez pu dire, en politique, il n’y a pas que des circonstances, il y a aussi des convictions. Ma carrière, et bien plus encore ma conduite, opposent un démenti criant à vos conceptions erronées de la politique : je suis l’exemple vivant de leur invalidité. En dépit de vos innombrables manœuvres, vous n’êtes jamais parvenu là où je suis arrivé. Toute votre vie durant, vous n’avez eu de cesse de côtoyer, de courtiser, de flatter, de conseiller et de servir les puissants de ce monde. Quelque intriguant que vous ayez été, vous n’avez jamais réussi qu’à vous hisser à la seconde place. Pourquoi ? Parce que précisément, vous n’avez jamais été qu’un intriguant. Il vous a toujours manqué cette force de conviction qui accompagne les révolutions et qui fonde les ordres nouveaux. Vous n’avez fait que suivre les régimes établis et profiter de leurs faiblesses ; vous avez précipité leur chute et encouragé leur naissance ; jamais vous ne les avez fondé, jamais, par conséquent, vous n’avez été à leur tête. Vous me faites penser à une sangsue, qui croît à l’ombre des régimes et à leurs dépends, avant de les abandonner une fois que ceux-ci dépérissent. Pour ma part, je n’ai jamais dévié. J’ai toujours défendu les mêmes principes, et quand les circonstances le permirent enfin, je suis arrivé naturellement au faîte du pouvoir. C’est la différence fondamentale qui existe entre vous et moi, et c’est ce qui distingue les maîtres des serviteurs : « Ceux qui aiment les richesses sont faits pour servir, et ceux qui les méprisent pour commander. »
Talleyrand : Je vous entends. Pour autant, l’expérience montre que lorsqu’un homme parvient à emporter le pouvoir suprême, il ne l’a plus pour très longtemps. C’est une loi éternelle que les hommes feraient bien de méditer davantage, si seulement l’ivresse du pouvoir ne la leur faisait pas oublier bien vite. Nous avons naturellement de l’inclination à vouloir la totalité du pouvoir pour soi ; or, le plus dur ne consiste pas à le ravir, mais à le conserver. Une fois arrivé au faîte, on ne peut que descendre, et c’est la raison pour laquelle je me suis bien gardé de convoiter la première place, quand même je l’aurais pu avoir. J’ai établi ce principe en considérant les revers de fortune de tous les princes qui se sont succédé en France depuis Louis XVI, et je m’y suis conformé toute ma vie durant. J’en ai conclus que la suprématie était une maîtresse infidèle, qui ne laisse jamais de tuer ses amants lorsqu’elle les quitte, sachant qu’elle finit immanquablement par les quitter, tôt ou tard. L’omnipotence du prince ou du tyran se confond avec sa vie : qu’il perde la première, et infailliblement, il perdra la seconde. En vertu de ce principe, je me suis efforcé de ne jamais monter à la première place, mais de toujours la suivre de près. La position de maire du palais est plus confortable qu’il n’y paraît : elle permet de faire les révolutions et de ne jamais en être la victime. Je dirais même plus qu’elle offre la possibilité, en cas de révolution, d’accéder provisoirement à la première place en toute impunité. Seulement, le caractère éphémère de cette promotion est la condition de son impunité : si celle-là doit durer, alors celle-ci s’évanouit. Lorsqu’un tel honneur se présente, il faut avoir la sagesse de rendre le pouvoir en temps et en heure au souverain légitime. C’est l’insigne privilège qui m’échût lors du retour des Bourbons ; et pendant quelques jours, j’ai pu me considérer, sans exagérations, comme le véritable maître de la France. J’ai pu goûter l’ivresse qui en résulte sans en devenir dépendant ; et pour cause : mon âge fut mon meilleur préservatif ; on ne commence pas une carrière de dictateur à 60 ans… (un temps) C’est ainsi que si l’on veut durer, il faut seconder ; je suis bien placé pour le savoir. Enfin, et entre nous soit dit, je préfère avoir été un éternel second qu’un autocrate omnipotent mais fugace. Il vaut mieux vivre une vie de plaisirs modérés qu’une seconde de jouissance absolue.
Robespierre : Oui, si l’on regarde le pouvoir comme une source de volupté, ce qui semble être votre cas. Mais si on le considère comme le moyen de changer le monde, alors…
Talleyrand : …Alors, on veut être Dieu, et on devient tyran. Et c’est comme tel que l’on finit sa vie : par une mort violente, dans l’opprobre et la haine publique.
Robespierre : Savez-vous qu’à peine un an après ma mort, le petit peuple de Paris me regrettait déjà ?
Talleyrand : Tout comme le peuple de France regrettait Bonaparte un an après son abdication, jusqu’au point de le remettre au pouvoir. Or, celui-ci n’en a pas moins été un maître implacable. Au reste, la suite des évènements n’a pas tardé à démontrer que les Français avaient eu tort de le choisir comme maître pour la seconde fois.
Robespierre : Je récuse toute comparaison avec Bonaparte ! Je n’ai rien à voir avec cet homme.
Talleyrand : Et pourtant, vous avez bien des points communs avec lui ; j’en vois au moins deux : l’un comme l’autre avez été jacobins ; l’un comme l’autre avez été maîtres de la France. Tous deux jacobins et tyrans, ou jacobins donc tyrans, devrais-je plutôt dire. Et j’ajouterais que Bonaparte, en tant qu’ancien disciple du jacobinisme, n’a pas fait honte à sa prime doctrine, bien au contraire, je dirais même qu’il l’a honoré mieux que vous. C’est dire s’il a été à bonne école ; c’est dire si l’élève a dépassé le maître.
Robespierre : Trêves d’épigrammes voulez-vous ? Faites-moi des reproches sérieux et fondés, ou alors taisez-vous.
Talleyrand : Très bien. Alors, je n’aurais qu’un seul reproche à vous adresser : c’est celui d’avoir usurpé votre pouvoir en vous faisant passer pour le tribun du peuple. Or, vous n’avez rien d’un tribun et rien du peuple. Le comble de l’obscénité est de se réclamer d’une classe à laquelle on n’appartient pas, à plus forte raison lorsqu’on lorgne sur une classe inférieure à la sienne. Du peuple, vous n’en avez jamais eu aucune des caractéristiques : vous êtes maniéré, précieux, pudibond, vous vivez dans l’abstraction et vous vous nourrissez d’idées pures. Mais il y a pis : on n’a jamais vu le chef de la sans culotterie porter autre chose que des culottes ! N’est-ce pas là le comble de l’hypocrisie ? Quand on a l’effronterie de se réclamer du peuple, on n’y ajoute pas l’inconséquence de s’habiller comme ses maîtres. On m’a souvent reproché mes manières mondaines et mon train de vie fastueux, mais qu’ais-je fais en cela qui contrevînt à mon statut de grand seigneur ? Que ne m’eût-on pas dit si j’avais pris le parti de singer le père Duchesne, et de me faire plus sans-culottiste que les sans-culottes ? C’est pourtant ce que firent quelques-uns de mes pairs mal inspirés, et non des moindres, puisque même Louis-Philippe d’Orléans désavoua son rang et sa naissance. Voilà que le propre cousin du roi embrasse la cause de la Révolution, et que travaillé sans doute par le zèle des nouveaux convertis, pousse le vice jusqu’à se faire Jacobin, siéger à la Convention, changer son nom pour le sobriquet grotesque de Philippe-Egalité, et voter la mort de sa propre race ! Vous-même avez été écoeuré par une telle démonstration de vertu républicaine, que partout ailleurs on eût appelé lâcheté et trahison. N’avez-vous pas dit de lui qu’ « il était le seul qui pouvait se permettre de ne pas voter la mort. » ? Avant de lui susurrer, en aparté : « Je ne t’en demandais pas tant » ? Allons, qu’avez-vous à répondre à cela ?
Robespierre : Qu’effectivement, Philippe-Egalité ne méritait que mépris et dégoût, car son ralliement à la Révolution n’était que feinte et opportunisme. Mais je vous objecterais que le dévouement ardent et sincère d’un Lepeletier, ci-devant marquis de Saint-Fargeau, rachète amplement les sombres égarements d’un Philippe-Egalité. Le premier est allé jusqu’à faire le sacrifice de sa vie pour la Révolution, tandis que le second a perdu la sienne pour l’avoir souillée. A mes yeux, Lepeletier sauve l’honneur de toute la noblesse de France : à la différence de vous, je trouve qu’il y a de la grandeur à renier ses origines féodales pour embrasser celles de l’humanité.
Talleyrand : Ainsi donc, si j’avais voulu mériter l’estime de Robespierre, il eût fallu que je renonçasse à l’héritage que m’ont légué mes aïeux, que je réprouvasse une maison illustre et pluriséculaire, que je méprisasse mon nom et mes titres, et que par-dessus tout, je me dépouillasse de mes richesses ? Non, cela m’est impossible ; et puis, je préfère encore être un seigneur libéral qu’un bourgeois thésaurisateur : j’ai déjà suffisamment de vices pour ne pas rechercher le pire de tous, l’avarice. (un temps) J’ai encore du mal à comprendre votre popularité auprès de la populace des faubourgs. Si au moins, elle résultait de vos talents oratoires, mais là encore, vous avez usurpé votre réputation. On vous a pris pour un grand rhéteur parce que vous monopolisiez la tribune, parce que vous exprimiez les alarmes les plus terrifiantes, parce que vous répétiez sans relâche les mêmes discours, parce que vous avez éliminé tous vos rivaux plus talentueux que vous, parce qu’à la fin, on entendait plus que vous. Le bon orateur ne subjugue pas par la terreur, mais par le charme ; il ne glace pas son auditoire, il l’enflamme ; il convainc par sa faconde et ses formules, non par des cantiques et des syllogismes fumeux ; il ne récite pas, il improvise ; il ne gémit ni ne glapit, il tonne. Si vraiment vous aviez eu quelque talent dans l’art oratoire, vous n’auriez pas été cet obscur avocat sans cause que la Révolution a tiré de sa torpeur. Sans elle, vous seriez resté tel toute votre vie.
Robespierre : Parfaitement ! Et loin de m’en affliger, je m’en enorgueillis ! Je n’ai jamais voulu défendre que des causes justes !
Talleyrand : Et qu’entendez-vous par causes justes ?
Robespierre : Celles qui se proposent comme objectif la défense des faibles et des opprimés.
Talleyrand : En ce cas, il ne faut pas vous étonner d’avoir manqué de clients. C’est précisément la raison pour laquelle vous n’êtes pas un maître de rhétorique. Car pour pouvoir l’être, il faut accepter de se battre pour des causes qui vous répugnent ; il faut avoir la souplesse de défendre un jour la victime et l’autre jour son bourreau ; il faut composer, jouer un rôle, exagérer, altérer ou embellir les faits. Si vous vous en tenez seulement à la vérité et aux causes que vous estimez justes, vous ne plaidez jamais…
Robespierre : Passons sur mon cas, voulez-vous ? Et occupons-nous du vôtre désormais. Pour ma part, j’ai tellement de griefs à vous faire que l’éternité ne suffirait pas à les exposer, mais si je ne devais en retenir qu’un seul, ce serait celui d’avoir confondu, au pouvoir, les intérêts publics avec vos intérêts privés…
Talleyrand : Et comment un homme qui n’a jamais eu d’autres intérêts que les intérêts publics, peut me faire un tel reproche ? J’en suis parfois à me demander si vous êtes vraiment humain.
Robespierre : Talleyrand, vous incarnez ce que j’ai toujours voulu éradiquer de la surface de la terre : l’aristocratie libérale et mondaine, fière de sa race et de ses valeurs, consumé de dettes et de petite vérole, aussi à l’aise dans les manœuvres de la haute finance que dans celles des salons, aussi habile dans les intrigues de cour que dans celles des alcôves. Votre canne est bien plus qu’une béquille : c’est le symbole même de la féodalité…
Talleyrand : …et votre serviette de clerc de notaire, celui de la bureaucratie. Vous représentez ce que j’ai toujours méprisé : la petite bourgeoisie besogneuse et puritaine, qui se contente de peu, qui se satisfait de vivre dans un taudis exigu, qui n’a pas d’autre luxe que sa mise, et qui ne connaît pas d’autres divertissements que ses lectures moralisantes.
Robespierre : Vous savez, je vous observe depuis que vous êtes arrivé, et je dois avouer qu’au moment où vous pénétrâtes dans cette pièce, j’eus soudain devant moi la vision du plus parfait et du plus détestable seigneur de l’ancien régime. Si ce miroir pouvait parler, il vous décrirait en ces termes : « J’ai vu entrer un personnage double, ambigu et suspect : sa mise tenait à la fois de la tenue de chancelier et du costume de bal. Il était maniéré comme un courtisan ; pompeux comme un prince. En dépit d’une claudication qui présageait un esprit retors, il allait son train de sénateur. Derrière son masque de civilité se cachait une face bouffie d’une vieille morgue aristocratique : un nez arrogant, un rictus ironique, des yeux voilés et un regard plein de condescendance. Sitôt entré dans la pièce, il se comporta comme le maître de céans, sûr de lui et de son bon droit. Il prit ses aises comme s’il habitait là depuis toujours, cherchant du regard quelque domestique, puis il alla s’asseoir sur le plus confortable des fauteuils, trônant au milieu de la salle, comme roi dans son palais. » Voilà le portrait que ferait de vous ce miroir, s’il pouvait parler.
Talleyrand : Soit… Et si maintenant on retournait ce miroir, que dirait-il ? Qu’il voit un homme terne et morose, à l’esprit étroit et mesquin, au tempérament bilieux, torturé par l’envie et la mélancolie, agité de convulsions nerveuses et rongé de tics…
Robespierre : (un temps) Certes, mais contrairement à vous, je peux encore me regarder dans un miroir.
Talleyrand : Si fait ! C’est d’ailleurs votre passe-temps préféré! Vous avez poussé votre amour de vous-même jusqu’à pendre vos portraits sur tous les murs de votre logis ! Et quels portraits ! Tous les mêmes, avec votre raideur, votre allure guindée, votre visage inexpressif, votre regard éteint et vos yeux vitreux.
Robespierre : Les vôtres ne sont pas moins tous ressemblants : toujours vêtu en habits de cérémonie, avec cet air impassible et altier, le sourire subtil, le regard méprisant et l’œil scrutateur…
Talleyrand : Vous savez, nous avons tort de nous quereller sur notre apparence physique. Il apparaît en effet que nous serions tous deux assez proches quant à la physionomie, du moins, si l’on en croit une vieille connaissance commune : « En voyant entrer chez moi Talleyrand, son visage blanc, insignifiant, mort, les yeux inanimés, fixes, je crus revoir Robespierre lui-même. Je fus encore plus frappé en le considérant de plus près : ces os saillants, cette tête courte, ce nez retroussé, cette bouche méchante et sèche, la même coiffure poudrée à blanc, le même port raide et immobile. » Ces mots sont de Barras…
Robespierre : Oui, hé bien, la comparaison de Barras s’arrête là.
Talleyrand : Très juste : Barras a causé votre perte ; moi j’ai causé la sienne.
Robespierre : Félicitations ! Vous pouvez vous enorgueillir d’avoir surpassé ce traître en perfidie !
Talleyrand : Et s’il n’y avait que lui ! Vous souvenez-vous de Fouché ? Un autre de vos fossoyeurs que j’ai évincé ce me semble…
Robespierre : Des traîtres que vous avez trahis ! Mais quand cesserez-vous donc de vous montrer odieux ? Vous semblez vous glorifier de tous vos sombres méfaits ! Vous êtes de loin la créature la plus vicieuse et la plus corrompue qu’il m’ait été donné de connaître. Je ne comprends pas ce que je fais ici avec vous : rien n’est plus insupportable que votre présence à mes côtés en ce moment.
Talleyrand : Eh, pourquoi ? Serait-ce parce qu’elle entache votre réputation d’homme vertueux ? Voyons, nous ne sommes pas ici par hasard, et vous êtes aussi coupable que moi, quoique vous en puissiez dire. Il est inutile de vous voiler la face : plus vous nierez vos crimes et plus votre présence ici sera justifiée. Vous m’êtes aussi odieux que je le suis pour vous ; mais à la différence de vous, je pense qu’on peut toujours rendre la situation plus facile, fût-ce en enfer. Pour cela, il suffit de composer, même avec ceux qu’on estime le moins.
Robespierre : C’est peine perdue : toute ma vie, j’ai refusé la compromission, ce n’est pas maintenant que je vais commencer, surtout pas ici, et encore moins avec vous.
Talleyrand : En ce cas, nous n’aurons pas volé notre châtiment. Est-ce là ce que vous désirez ? La conformité aux principes vaut-elle la damnation éternelle ?
Robespierre : Hors de ma vue. Vous avez bien mérité la vôtre, homme perverti.
Talleyrand : Fort bien. Mais s’il faut être damné, je préfère encore être l’homme perverti que l’homme inverti…
Robespierre : Qu’insinuez-vous, perfide ? Expliquez-vous ?
Talleyrand : Qu’il est préférable d’être en enfer en sachant pourquoi on y est, et qu’à tout prendre, il vaut mieux être un vicieux qui s’assume plutôt qu’un vicieux qui s’ignore. En ce sens, votre châtiment est bien pire que le mien : je sais pourquoi je suis là, je connais mes crimes. Mais vous ? Vous êtes toujours persuadé d’avoir fait le bien. Existe-t-il tourment plus cruel ? Moi, je mérite ma peine, et celle-ci est d’autant moins difficile à souffrir que j’en sais les raisons, tandis que vous, vous cherchez encore les vôtres… Vous devez endurer les souffrances les plus atroces… Et pourtant vous ne vous plaigniez pas... Vous souffrez en silence, comme vous l’avez fait durant toute votre vie… Admettez que c’est là un sort bien cruel : le malheur éternel comme unique récompense du malheur terrestre. A quoi vous a servi cette vie d’austérité et de privations, dites moi ? Au même point que moi, qui a passé la mienne dans la volupté et l’opulence, et qui l’a prolongée le double de la vôtre…
Robespierre : Toujours dans vos méprisables petits calculs. Et vous vous étonnez de votre sort ? Vous avez voulu négocier avec Dieu – faut-il être fou ?
Talleyrand : Je dis qu’il est moins fou d’avoir voulu négocier avec Dieu que d’avoir voulu le supplanter.
Robespierre : Calomnies ! Je n’ai jamais prétendu devenir Dieu ; c’est bien mal comprendre le sens de ma politique. On me blâme parce que j’ai voulu remettre la crainte de Dieu dans le cœur des hommes. Mais cela, vous ne pourrez jamais le comprendre, évêque défroqué que vous avez été : toute votre vie, vous avez cherché à renier votre sacerdoce ; durant toute la mienne, je me suis efforcé de me conformer à celui que je m’étais forgé.
Talleyrand : Sur cet article, je serais d’une extraordinaire mauvaise foi de vous opposer le moindre démenti. Je ne puis que reconnaître ce que tout le monde sait déjà depuis toujours : oui, j’ai contrevenu à mes vœux de pauvreté et de chasteté, et accessoirement je n’ai jamais observé le jeûne du Carême… Mais j’affirme que celui qui a passé sa morne existence à jeûner dans la pauvreté et l’abstinence, sans en avoir jamais prononcé les vœux, est aussi coupable que celui qui, les ayant prononcés, ne les a pas observés.
Robespierre : Vous osez me reprocher ma conduite ? Vous dont la vôtre est entachée de tous les travers possibles ? Et sur quel motif ?
Talleyrand : Sur le motif qu’on ne se comporte pas en prophète quand on veut être roi ; autrement dit, on ne fait pas de morale quand on embrasse une carrière politique. Vous n’avez cessé de dénoncer la corruption morale et matérielle de vos pairs successivement à l’Assemblée nationale, à la Constituante, à la Législative et à la Convention. Seulement, vous n’avez jamais compris, ou n’avez jamais voulu comprendre, que la corruption est inhérente à l’exercice du pouvoir. Que devient un roi qui veut jouer au prophète ? Il cesse d’être roi et n’en devient pas prophète pour autant. On ne peut gagner sur tous les tableaux à la fois, sans se faire sanctionner à un moment ou un autre. A bien des égards, vous me faites penser à Savonarole : comme lui, vous n’avez cessé de dénoncer la corruption de vos contemporains, comme lui, vous avez voulu réformer les moeurs publiques, comme lui, vous fûtes d’abord piètre orateur avant de devenir le redoutable tribun que l’on sait, comme lui, vous fûtes sincère, fascinant et inexorable, comme lui, vous avez fait régner sur vos concitoyens une terreur d’inspiration vertueuse, comme lui, vous avez voulu leur imposer votre propre morale, aussi sublime dans l’esprit qu’impraticable dans les faits, comme lui, vous avez instauré une dictature de type théocratique, enfin, comme pour lui, l’apogée de votre pouvoir a précédé de peu votre chute : le sermon de l’Ascension pour lui, la fête de l’Etre Suprême pour vous ; et dans un cas comme dans l’autre, une mort ignominieuse, point de départ d’une réaction thermidorienne, où les vices longtemps refoulés se sont exprimés dans une orgie de débauche… Il est intéressant de remarquer que l’Histoire enfante de telles abominations à intervalles réguliers ; c’est souvent à la faveur de révolutions que sortent du néant ces prédicateurs-dictateurs, porteurs de réformes politico-religieuses, et qui se croient investis d’une mission divine. Fort heureusement, s’ils sont dangereux, leurs apparitions restent rares. Au reste, il est aisé de les reconnaître : ce sont des monstres dans l’ordre politique ; leurs comportements ne ressemblent point à ceux des autres princes, leurs projets sont démentiels et absurdes, leur discours mâtinés de mysticisme fait leur succès autant qu’ils causent leur perte, enfin, leur mode de vie à rebours de celui des monarques trahit leur usurpation. C’est encore sur cet article que vous vous distinguez particulièrement, Robespierre : a-t-on idée, quand on règne sur un empire grand comme la France, de vivoter dans une misérable bicoque? Jamais souverain aussi absolu n’a eu un palais aussi peu digne de son pouvoir. Le maître des Français vivait comme un domestique ! C’est tout juste si vous parveniez à dépenser la totalité de votre indemnité parlementaire…Vous avez toujours mis trop de religion dans votre politique, Robespierre…
Robespierre : Et vous, trop de politique dans votre religion : quand on embrasse la carrière ecclésiastique, on ne la dénature pas en troquant la mitre pour le turban empanaché de grand Chambellan.
Talleyrand : Eh oui, mais que voulez-vous ! Je suis né dans un siècle où les charges ecclésiastiques pouvaient encore favoriser les ambitions politiques. Richelieu, Mazarin, Fleury, les cardinaux respectifs de Louis XIII, Louis XIV et Louis XV n’ont-ils pas été en leur temps, les plus puissants ministres du royaume ? Malheureusement, la Révolution a renversé cet usage, et si ma charge d’évêque pouvait me servir sous l’Ancien Régime, elle ne pouvait que me nuire sous le Nouveau. Aussi dus-je renoncer à la carrière ecclésiastique pour conserver des chances dans la carrière politique. Mais je vous accorde que la charge de grand Chambellan sous l’Empire le cède de beaucoup à celle de cardinal sous la monarchie, et en tout cas, elle fut bien en deçà de mes ambitions.
Robespierre : « Qui n’a pas les moyens de ses ambitions en a tous les soucis. », n’est-ce pas vous qui êtes l’auteur de cet adage ?
Talleyrand : Oui, en effet… Je vois que vous utilisez jusqu’à mes propres maximes pour les retourner contre moi… Hé bien oui, j’admets que celle-ci peut s’appliquer à ma personne. Mais vous me voyez surpris – et pour tout dire, flatté – de vous entendre citer une formule dont j’ai la paternité. C’est le signe que mes cajoleries commencent à faire leur effet. Bientôt nous trinquerons ensemble, et encore quelques heures, et vous me donnerez du « Monseigneur ».
Robespierre : Votre insolence trahit vos origines : ce sont celles de l’aristocratie irrémédiablement dévoyée. Plus je vous côtoie et plus j’en viens à cautionner les massacres de la Révolution. Face à de pareilles créatures, il n’est pas de rémission possible ; il faut les éliminer jusqu’à la dernière.
Talleyrand : Ecoutez-vous parler ! Les derniers mots que vous venez de prononcer sont bien plus insolents que ceux que vous me reprochez d’avoir tenu à l’instant… Mais nous n’arriverons à rien en nous crachant mutuellement du fiel à la figure. De grâce, revenons à la raison et reprenons le propos qui nous occupait.
Robespierre : J’y consens. (un temps) Alors, selon vous, un bon prince est nécessairement corrompu ou vicieux ? Laissez-moi vous dire que je ne partage pas du tout cette opinion. Et je ne suis pas le seul. Platon ne préconisait-il pas de confier le pouvoir de la République aux philosophes et de laisser le commerce aux marchands ? Le pouvoir et la richesse ne doivent pas être concentrées entre les mêmes mains, sinon, il n’y a plus de République. Et quand l’argent corrompt même la religion, alors, il n’y a plus de société, et c’est la tyrannie qui l’emporte. Mais vous savez fort bien de quoi je parle : vous avez profané le sanctuaire de la morale par vos machinations politiques et financières.
Talleyrand : Cela est vrai, je le concède. Rétrospectivement, je pense que j’aurais dû mettre plus de morale dans ma finance et ma politique, peut-être cela m’aurait-il sauvé…En revanche, ce qui est certain, c’est que si vous aviez mis un peu de finance et de diplomatie dans votre morale, vous auriez évité le pire…du moins, provisoirement…
Robespierre : Encore des insinuations ! Ne pouvez-vous donc pas exprimer une idée sans la travestir ?
Talleyrand : Vous ne voyez pas ? Pourtant, lors de la séance du 8 thermidor à la Convention, si vous aviez su de quoi vous parliez, lorsque vous accusâtes Cambon de prévarication, vous auriez peut-être réfléchi à deux fois avant de l’attaquer, lui et son système financier auquel vous n’entendiez rien. Car, en dénonçant cet homme intègre, peut-être le seul dans toute la Convention – à l’exception de vous-même, bien entendu –, vos avez provoqué sa juste colère et précipité votre chute : pour la première fois, une de vos victimes osa répondre à vos accusations et les retourner contre vous :
«Avant d'être déshonoré, je parlerai à la France ! Il est temps de dire la vérité tout entière : un seul homme paralyse la Convention et cet homme, c'est Robespierre ! »
Et votre sort était scellé : il n’en fallait pas plus pour renverser une Convention travaillée par vos ennemis. Pourtant, avec un peu de diplomatie et de corruption… (un temps) Vous ne régniez alors que par le verbe, et les discours étaient les seules gratifications que vous octroyiez à vos esclaves. Mais les hommes ont besoin de rétributions plus concrètes, et les mots, s’ils sont nécessaires, ne peuvent suffire seuls à établir durablement une domination. D’ailleurs, il est révélateur de remarquer qu’en vous empêchant de parler, vos ennemis vous ont privé de l’unique source de votre pouvoir. Qu’est-ce que Robespierre à la tribune ? Le Verbe incarné de la Révolution, le démiurge de la Terreur : chacune de ses paroles a une conséquence sur l’ordre physique. Que devient-il sans elle ? Un affabulateur insignifiant ; il retourne dans le néant, sa demeure naturelle, d’où il n’aurait jamais dû sortir…
Robespierre : Je ne vous permets pas ! Cette fois-ci, je n’y tiens plus, Talleyrand ! Il est temps de faire séance tenante le procès de tous vos crimes, que pour leur plus grande honte, vos contemporains n’ont pas eu le courage de vous intenter de votre vivant ! La liste est longue, mais je m’en tiendrais aux faits essentiels : vous êtes un corrupteur corrompu, le traître des traîtres, le plus débauché des sybarites, le plus satanique des ecclésiastiques, le serviteur autant que la sangsue des princes, le conseiller autant que le manipulateur des puissants, l’amant autant que le suborneur de toutes les femmes… (Talleyrand se met à ricaner) Et vous avez l’impudence de rire à l’exposé de vos crimes ?
Talleyrand : Je ris parce que vous êtes pathétique…A quoi vous sert de déclamer contre moi ? Pourquoi un tel réquisitoire ? Vos incantations de sorcier des tribunes sont sans effet ici : il n’y a plus d’assemblée pour écouter vos saintes anathèmes, plus de jacobins pour boire chacune de vos divines paroles, plus de sans-culottes pour conspuer l’objet de vos critiques, et plus de Marais pour applaudir docilement chacune de vos interventions. Vos cris d’orfraie ne suscitent plus l’effroi ; vos yeux sournois ne dardent plus leurs regards obliques et assassins ; vos interpellations ne sont plus des arrêts ; vos phrases plus des sentences ; vos prédictions plus des prophéties ; votre verbe, autrefois si puissant, est devenu aussi vain que le soupir d’un spectre ; votre élocution, auparavant sèche et aiguisée comme le couperet de la guillotine, n’est plus que le râle inoffensif d’un paranoïaque en proie au délire ; vos discours, écrits en lettres de sang, ne constituent plus les oraisons funèbres de vos ennemis, réels ou imaginaires… Tout ceci est fini, Robespierre…
Robespierre : (un temps) Talleyrand, je vous exècre, je voudrais vous mortifier, vous dénoncer, et vous faire disparaître… Mais vous avez raison : je ne puis le faire qu’en haut d’une chaire, appuyé sur un pupitre et entouré d’une assistance subjuguée. Dans le particulier, je suis impuissant ; je reste ce que j’ai toujours été : courtois, délicat, et incapable de menacer qui que ce soit.
Talleyrand : Je ne vous hais pas moins, Robespierre. J’aimerais vous circonvenir, vous duper et vous trahir. Contrairement à vous, je redoute le débat public ; c’est dans les recoins des cabinets et des antichambres que se déploie toute la mesure de mes talents. Mais vous êtes probablement le seul homme au monde sur lequel mes prévenances soient vaines.
Robespierre : (un temps) Nous ne pourrons jamais nous entendre, vous-mêmes venez d’en convenir ; il est inutile de vouloir nous rapprocher. Brisons-là et retirons-nous chacun dans un coin de cette pièce. Nous passerons l’éternité à méditer dans la solitude.
Talleyrand : Je regrette, mais je me vois dans l’obligation de refuser. Cette option vous est nettement plus favorable qu’à moi : si vous préférez la compagnie de la solitude, vous semblez oublier que je ne me complais que dans le monde : « Etre du monde, quel ennui ! – Mais ne pas en être, quel drame ! » La peine n’est pas équitable : des deux, c’est moi qui souffrirais le plus.
Robespierre : Quoi de plus juste ? Des deux, c’est vous le plus grand criminel.
Talleyrand : C’est vous qui le dites. Encore que je ne sache pas qu’en enfer, les peines soient proportionnées aux crimes. Le traitement doit y être le même pour tous, sinon, nous nous trouvons au purgatoire.
Robespierre : Le purgatoire ! Voilà un concept qui vous sied à merveille et qui résume parfaitement votre personnalité : la demi-mesure, l’entre-deux, la tergiversation, l’atermoiement, la négociation, le compromis… Vous ne recherchez que les solutions médianes.
Talleyrand : J’ai toujours eu de l’aversion pour tout ce qui était absolu : les régimes comme les tempéraments…
Robespierre : Précisément, alors pourquoi vouloir nous concilier ? N’insistez pas, je refuse de poursuivre plus avant cette conversation. Vous perdez votre temps avec moi.
Talleyrand : Le temps ne nous est plus compté désormais. J’ai l’éternité pour vous enjôler, je finirais bien par arriver à mes fins. Il serait plus sage de vous montrer coopératif, cela nous éviterait bien des désagréments.
Robespierre : Je crois que vous ne savez pas bien à qui vous avez affaire : je suis resté inexorable à toutes les prières dans ma vie, même à celles de mes amis les plus chers. Quand Lucille Desmoulins me demanda la grâce de son mari, en invoquant le sort de son fils dont j’étais le parrain, je l’ai éconduite sans hésiter. Pensez-vous être plus touchant et plus pitoyable qu’une épouse éplorée, sur le point de perdre son mari et sa vie ?
Talleyrand : Non, évidemment… Mais enfin, ne pouvons-nous pas trouver un terrain d’entente ?
Robespierre : Jamais deux individus ne furent plus opposés de caractère que vous et moi. Vous êtes sot d’avoir cru pouvoir nous accorder.
Talleyrand : (un temps) Je vois ! Si c’est là votre souhait, alors qu’il en soit ainsi ! Oui, rien n’est plus dissemblable que nos deux caractères. Puisque vous voulez rappeler les lieux communs, eh bien soit : l’un est vénal, l’autre incorruptible ; l’un superbement parjure, l’autre terriblement sincère ; celui-là vit dans une insolente opulence, celui-ci dans une indigence évangélique ; le vice de l’un n’a d’égal que la vertu de l’autre ; l’un a trempé dans tous les trafics, l’autre en est pur ; l’un est débauché, l’autre chaste ; l’un a passé sa vie à nouer des intrigues, l’autre a passé la sienne à les dénoncer ; l’un n’a jamais observé le moindre principe, l’autre n’a jamais dérogé aux siens ; l’un est un vil pragmatique et l’autre un dangereux idéaliste… C’est la chanson officielle que vouliez, n’est-ce pas ? Avouez que dit de la sorte, l’énumération m’est largement à charge… Ne croyez-vous pas que cela est un peu trop facile ?
Robespierre : Que voulez-vous, Talleyrand, on ne fait pas de fumée sans feu. Fort heureusement, votre disgrâce physique a prévenu vos contemporains en votre défaveur : elle était le sceau autant que le châtiment de votre perfidie. Telle la queue du diable, elle trahissait vos manières urbaines et caressantes, avertissant par là les âmes pures de votre esprit maléfique… Votre pied laisse la trace d’un sabot derrière chacun de vos pas, et vous vous étonnez de votre réputation sulfureuse ?
Talleyrand : Voyons ! Ne me débitez pas ces misérables poncifs ! Pas vous ! Vous valez mieux que ça, Robespierre. Je vous ai connu autrement habile pour disqualifier un adversaire. De tels propos ne sont pas dignes de vous ; ceux qui ont usé de la comparaison avec le diable l’ont fait à court d’argument… Et toujours ce pied bot ! Quand cessera-t-on de me parler de lui comme d’une malédiction, comme d’un gouvernail qui aurait présidé à ma destinée ?
Robespierre : Ne jouez pas l’offensé : vous avez été le premier à dire que votre vocation vous venait de votre jambe !
Talleyrand : Oui, en effet, force m’est de le reconnaître… De toutes façons, il m’est impossible de mentir, ici… (un temps) Que serait devenu Talleyrand sans son pied bot ? Un homme vertueux ? Peut-être… Et quand je le fusse devenu, serais-je pour autant devenu un Robespierre ? Assurément non. Bien que vous ayez toujours voulu associer votre nom à celui de la vertu, icelle n’a jamais été votre compagne, et ne le sera jamais, même dans la postérité. « Qui veut faire l’ange… »
Robespierre : Et puis après ? Est-ce une raison pour se vautrer dans le vice ? En outre, je vous ferais remarquer que la réciproque n’est pas vraie : qui veut faire la bête, ne fait pas l’ange pour autant. Si vous espériez me donner le change par un chiasme en votre faveur, vous avez lamentablement échoué.
Talleyrand : Vous vous méprenez : il n’y avait aucune malice dans mon propos ; votre suspicion vous égare. Ce que je voulais simplement vous dire, c’est qu’il ne suffit pas de vouloir être vertueux et de le faire savoir, pour le devenir effectivement.
Robespierre : Comment pouvez-vous dénier la vertu à un homme qui toute sa vie a combattu le vice ?
Talleyrand : « Qui hait les vices, hait les hommes ». Cet aphorisme n’est pas de moi, je le tiens de Danton, mais je mettrai ma main à couper que celui-ci l’a prononcé en pensant à vous.
Robespierre : La misanthropie n’empêche pas la philanthropie ; au contraire, je dirais même que les deux sont consubstantielles. Les plus grands misanthropes n’étaient-ils pas également de grands philanthropes ? Prenez Zénon, Plutarque, Luther, Pascal, Rousseau, et tant d’autres… Tous ces grands moralistes ne partageaient-ils pas le même souci de l’homme ? Je ne fais pas exception à la règle. Les hommes sont tellement décevants, imparfaits et corruptibles, que je résolus de les relever de leur indignité en adoptant une conduite exemplaire. Au moins, me disais-je, si tous mes semblables sont impurs, moi, je serais le seul à mériter la qualité d’homme. Et par mon unique exemple, je prouverai à l’univers qu’il ne faut pas désespérer du genre humain. Ainsi, pensais-je, l’opprimé qui vit sous le joug de la tyrannie saura trouver en moi un frère compatissant – mieux, un défenseur. Je serai le porte-parole des sans voix, le consolateur des affligés, le soutien des plus faibles, le justicier des victimes innocentes, la sentinelle du bien et de la vérité… Par l’exercice de la vertu, j’aurais doté mes semblables des plus sages institutions, et grâces à elles, j’aurais réformé leur conduite. Les hommes seraient enfin devenus dignes d’être appelés tels…
Talleyrand : J’ai du mal à vous croire…
Robespierre : Et pourtant, je parle à cœur ouvert.
Talleyrand : Quand vous seriez aussi sincère que vos modèles, vous n’en serez jamais qu’un disciple doctrinaire et borné… Les grandes écoles de pensée ont besoin de visionnaires pour les fonder et de fanatiques pour en préserver le dogme. L’esprit des premiers est aussi ouvert que celui des seconds étriqué. Et malheureusement pour vous, si vos modèles appartiennent à la première catégorie ; vous n’appartenez qu’à la seconde. Vous vous vouliez moraliste ; vous n’avez été que moralisateur… Au reste, il y a un monde entre la théorie et son application. La première est tout au plus divertissante, au pire ridicule ; la seconde peut-être dévastatrice…
Robespierre : Vous me reprochez d’avoir voulu réformer la société ?
Talleyrand : Non pas d’avoir seulement voulu, mais d’avoir surtout essayé.
Robespierre (un temps) : Oui, j’ai été inexorable, mais la grandeur de la mission que je m’étais fixée me l’imposait. En dehors de la sphère publique, j’étais aussi irréprochable, honnête et vertueux que le plus pur des citoyens de la plus parfaite des républiques. Jamais je n’ai trompé un de mes semblables, que ce soit en affaires, en amour ou en amitié : je n’ai corrompu personne, friponné aucun de mes clients, manqué de respect à aucun de mes supérieurs, abusé d’aucun de mes subordonnés et menti à aucun de mes commettants. J’ai toujours vécu conformément aux principes que j’énonçais ; je n’ai dérogé à aucun de mes devoirs. Jamais homme n’eut à se plaindre de mon commerce ; jamais je ne me suis oublié en présence d’une femme. Mes concitoyens peuvent me reprocher de les avoir traités avec rigueur, jamais ils ne pourront me reprocher de les avoir floués et avilis. Ceux qui vous côtoyaient étaient sûrs de rester en vie, mais ils redoutaient vos perfidies ; ceux qui me connaissaient savaient que, s’ils échappaient à la mort, rien de fâcheux ne pouvait leur arriver. On m’a accusé de n’avoir eu aucune considération pour la vie humaine, or jamais homme n’en eût plus que moi, tant il est vrai que la tromperie est plus attentatoire à l’humanité que le simple fait de lui donner la mort. Et encore ! Sous la Constituante, il n’y avait qu’un seul député pour s’élever contre la peine capitale, à rebours de l’opinion de tous les autres ; et ce député n’était autre que moi. Si par la suite, j’ai appelé de mes vœux l’élimination physique des ennemis de la patrie, c’était pour le bien public. Les circonstances l’exigeaient. Mais jamais, au grand jamais, je n’ai souhaité ni cautionné les excès de la Terreur, et c’est bien pour ça que j’ai fait rappeler les représentants en mission les plus dévoyés. Et notez bien ceci : les morts qui me sont imputables ont été des morts légales, exécutées dans le cadre de la loi. Je n’ai jamais envoyé des sicaires assassiner un ennemi dans quelque sombre guet-apens ; de tels procédés me répugnent, je les laisse à mes ennemis.
Talleyrand : Vous vous donnez bonne conscience en vous prévalant d’avoir agi dans les formes légales, mais dites-moi, depuis quand la loi est-elle juste ? Une loi monstrueuse peut parfois engendrer des actions bien plus abominables que la dernière sauvagerie. Celle du 22 prairial est à cet égard symptomatique : sitôt entrée en application, le nombre des exécutions a dépassé en quelques mois celui de tous les guillotinés de la Révolution, surclassant largement les massacres de septembre ou les coupe-gorge de Vendée, sinon par leur horreur, du moins par leur étendue. Vous pouvez vous féliciter d’avoir enfanté un chef-d’œuvre d’inhumanité par cette loi ; avec elle, même le pire des criminels serait fier de se dire légaliste, et c’est bien ce qui est arrivé. Car comment appeler autrement un homme tel que Carrier ? Non content de se distinguer par sa cruauté, il s’illustra également par son ivrognerie, sa débauche et même sa démence. Alors vous aurez beau soutenir qu’il est préférable de guillotiner légalement, permettez-moi d’être sceptique…
Robespierre : Certes, vous me direz qu’il est plus noble d’assassiner un prince du sang dans des douves sordides, sans autre forme de procès, et ce, après l’avoir préalablement fait enlever en territoire étranger, au mépris de toutes les lois humaines, civiles et internationales.
Talleyrand : Contrairement à vous, je ne pense pas qu’une pauvre victime de la raison d’Etat puisse souffrir la comparaison avec dix milles guillotinés, fussent-ils reconnus coupables par une loi inique. Et puis je vous ferais remarquer, puisque vous revenez encore sur la regrettable affaire du duc d’Enghien, qu’en dépit de tout le zèle que vous avez mis à éradiquer les aristocrates, vous avez tout de même réussi à manquer le plus notable d’entre eux, ce qui démontre bien, s’il était encore besoin, le caractère aveugle et inopérant de votre loi sanguinaire.
Robespierre : Eh ! Qu’importe le prix à payer ! Si pour bâtir une république vertueuse, l’élimination des fripons doit entraîner celle de quelques innocents, je ne balancerais pas un instant, quand même il se trouverait parmi eux les plus talentueux des hommes ! Songez que les consignes que j’avais donné aux représentants en mission de la Convention n’étaient pas moins rigoureuses : ces derniers avaient pour ordre de désigner des hommes en fonction de leurs talents et de leurs vertus, mais que s’il fallait choisir entre ceux-ci et celles-là, ils devaient privilégier les secondes aux premiers, et rechercher des hommes incompétents et vertueux plutôt que talentueux mais vicieux.
Talleyrand : Incroyable… Je n’en reviens pas. J’ai beau sonder les tréfonds de votre âme, je n’y perçois qu’une navrante sincérité, d’autant plus déplorable que vous êtes dépourvu de remords. Vous êtes resté le même, jusque dans la mort…
Robespierre : Parce que vous pensez avoir changé ?
Talleyrand : Non, effectivement… C’est peut-être ce qui explique ma présence – et la vôtre – en ce lieu… Si nous étions véritablement au ciel, nos âmes seraient transfigurées par la bonté divine…
Robespierre : Vous croyez en Dieu à présent ?
Talleyrand : Oui, maintenant que je sais qu’il existe ! Si nous nous trouvons céans vous et moi, c’est bien par sa volonté ! Son existence ne fait plus aucun doute pour moi.
Robespierre : Malheureusement, il est trop tard pour croire. C’est le juste châtiment des athées.
Talleyrand : Serait-ce que vous vous considérez comme tel ? Je ne sache pas que le promoteur du culte de l’Etre Suprême ait nié son existence.
Robespierre : Non, bien sûr. Seulement, ma croyance ne m’a pas préservé de la damnation… Quelle ironie ! Je n’ai jamais cessé de défendre la divinité ; vous l’avez toujours ignorée, méprisée, persiflée, vous avez foulé aux pieds ses principes les plus sacrés et ses devoirs les plus saints, et pourtant ! L’un comme l’autre, nous nous retrouvons ici… En ce lieu que nous étions persuadés de ne jamais connaître : vous, parce que vous n’y avez jamais cru ; moi, parce que je n’avais jamais pensé y croupir un jour…
Talleyrand : Vous savez Robespierre, toute ma vie, et contrairement à vous, je me suis battu pour empêcher que toute situation ne devienne définitive. Et je ne puis me résoudre à croire que celle-ci le soit.
Robespierre : Vous vous bercez d’illusions : le jugement de Dieu est par définition définitif et irrévocable.
Talleyrand : Sans doute. Mais vous souvenez-vous avoir été jugé ? Qui sait si le tribunal céleste n’est pas au-devant de nous ? Et si tel était le cas, ne penseriez-vous pas qu’il y aurait encore quelque espoir ?
Robespierre : Vous croyez sincèrement pouvoir fléchir Dieu par vos belles paroles ?
Talleyrand : Non, mais on peut toujours faire appel à sa miséricorde, un sentiment dont vous avez été pour le moins avare de votre vivant.
Robespierre (soupire) : Talleyrand… Toutes les fois que je dénonce vos tares, vous me confondez en me montrant les miennes. N’avez-vous pas remarqué que depuis que nous disputons tous les deux, nous n’avons cessé de nous renvoyer mutuellement nos fautes au visage. Comme si Dieu avait voulu que je fusse votre juge et que vous fûtes le mien…
Talleyrand : Avec un juge tel que vous ? On aurait voulu me condamner qu’on ne s’y serait pas pris autrement.
Robespierre : Oui, vous avez raison. Pas tant un juge qu’un procureur, en fait. Et qui mieux que moi pour assumer cette tâche ? Quant à vous, vous… (la porte s’ouvre) Attendez… La porte… Elle s’est ouverte…
Talleyrand : Comme nos consciences…
Robespierre : Nous allons pouvoir quitter ce lieu… Nous n’étions donc pas en enfer… mais plutôt dans… l’antichambre de l’enfer ?
Talleyrand : …Ou du purgatoire.
Robespierre : Pourquoi la porte s’est-elle ouverte seulement maintenant ? Quel était le but de cette étrange confrontation ?
Talleyrand : Peut-être de nous faire avouer nos péchés…
Robespierre : Mais pourquoi Dieu a-t-il besoin de vous pour connaître les miens, et de moi pour connaître les vôtres ?
Talleyrand : Il les connaît déjà ; il avait besoin de les entendre de la bouche même des pêcheurs que nous sommes. Dans l’épanchement de nos âmes, nous nous sommes accusés réciproquement. Nous avons été l’accusateur de l’autre aussi bien que de nous-mêmes.
Robespierre : Quelles peuvent bien être les conséquences de tels réquisitoires ?
Talleyrand : Peut-être influenceront-ils le jugement divin…
Robespierre : En ce cas, vous devriez avoir peur.
Talleyrand : Et pas vous ?
Robespierre : Il n’y a qu’un seul moyen de le savoir…
Talleyrand : Alors après vous Robespierre. Vous étiez là le premier.
Robespierre sort, suivi de Talleyrand.