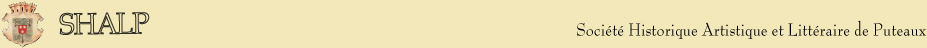


Littérature > Publications > Autour de ... Métro > Métrodorat
![]()
Metrodorat
par Stéphanie Albarède
Lundi. Je somnole entre Châtelet et gare du Nord. Ma tête ballotte au gré des secousses du wagon. Mon front cogne par intermittence le verre poussiéreux de la fenêtre ; chaque choc met à mal ma léthargie, rendant l’évasion chaotique, les rêveries inachevées. Je tente vaguement de replonger dans la quiétude d’une étreinte imaginaire. Le métro ralentit laissant supposer une trêve, l’instant d’un arrêt, avant la sonnerie stridente des portes. Mais la trêve n’est pas pour aujourd’hui ; juste avant l’entrée en gare, une odeur vient m’agresser. Une odeur de freinage ? Odeur métallique, mélange de graisse et de longeron échauffé, expression de la souffrance de l’acier laminé sous la friction corrosive des roues. Cette odeur écœurante semble coller à la peau, asphyxiant les pores du visage. A l’étreinte que je tente de retenir se superpose l’image d’un carré de coton où le blanc immaculé a laissé place à la grisaille des mines…
Mardi. Opéra, je l’aperçois face à la porte, empêtrée dans ses sacs du Printemps. Beauté parfaite, lèvres glacées, ourlées d’une ombre sensuelle, contours des yeux à peine marqués, soulignant un regard infini, véritable lac d’émeraude. Lorsqu’elle s’élance dans la rame, emportée par le torrent des usagers, un flot de senteurs sur fond poudré l’accompagne. Je connais ce parfum qui caresse mon imagination, qui m’emplit de bien-être. L’odeur de bergamote vient cajoler celle de rose épicée. Alors, les notes d’œillet et de jasmin s’unissent et me projettent dans le passé. Je revois deux colombes, « l’Air du temps » m’a rattrapé. J’oublie les stations pour laisser libre cours à mes souvenirs, fermant les yeux pour mieux humer la fragrance légère de l’inconnue…
Mercredi. Jour de pluie. Arrêt place de Clichy. Je suis plongée dans un livre, carnets d’un voyage au Sahara. Sous mes yeux se déroulent des kilomètres de sables dorés, j’imagine sur ma peau la brûlure du soleil. La foule monte, me bouscule, mon livre glisse. Je tente de reprendre ma lecture. Mais les images de dunes font place à un paysage lunaire où les monticules ont la couleur de la cendre ; la sensation de chaleur laisse place à la morsure du froid. Soudain, s’impose à moi l’image d’un plat de mouton fumant, de mouton faisandé. L’Islande m’apparait dans toute sa splendeur. Je me retourne pour regarder le catalyseur de cette songerie. Il est là, trempé jusqu’à l’os, tremblant de peur ? De froid ? L’eau dégouline le long de ses poils, créant une flaque sous ses pattes. Les passagers se sont écartés malgré un regard implorant un peu de chaleur humaine ; l’odeur de chien mouillé dérange. Je souris à cette odeur désagréable. Moi, elle me rappelle ce plat que je n’ai pas eu le courage de goûter un jour dans un désert de lave…
Jeudi. Elle est montée à Stalingrad, parfumée de ses voiles de soie, vêtue de ses notes épicées. Elle s’est assisse en face de moi. Mon regard s’est pris au piège de ce point rouge qui marque son front. Mon esprit tente en vain de se rappeler le sens des couleurs. Rouge, signe de quel état ? Libre ? Mariée ? Mon coup d’œil déclenche son malaise. Elle se trémousse sur le skaï de la banquette. A chaque mouvement, le scintillement de son sari semble libérer de petites bulles d’arômes. Le wagon prend les senteurs d’un marché aux épices où l’odeur du Tandoori régnerait en maître. Je plisse les yeux et imagine que le jaune safrané de ses voiles, le rouge piment et le vert thé des laines de nos voisins sont des petits tas coniques de poudres végétales…
Vendredi. Porte de la Villette. Je sens monter en moi la nausée alors qu’une odeur fade emplit peu à peu le wagon, mélange écoeurant d’un soupçon de vétiver et d’un flot d’exsudat humain. L’odeur aigrelette de sueur estompe rapidement les attaques du déodorant évoquant un travail forcené et éprouvant. J’imagine les deux hommes qui discutent derrière moi, habillés en bleu de travail souillé de gouttelettes de peinture, les mains calleuses. Je me retourne, indulgente, pour me diriger vers la porte. Le bleu est blanc ; la tenue est un survêtement ; les deux hommes, campés sur des jambes écartées pour résister aux ondes de freinage, le sac de sport jeté sur l’épaule, arborent un sourire suffisant de bellâtre à l’image de l’agression olfactive qu’ils nous imposent…
Samedi. Porte Dorée. Une odeur délicate, suavité de bonbon caramélisé, s’engouffre dans la rame. Les portes se referment. Il est là, le petit bonhomme en culotte courte. La foule s’écarte, effrayée devant la menace de la pomme triomphante. Il la promène au bout de son bras tendu, dans sa robe de caramel rutilant. La peur du sucre collant laisse place sur les visages à une expression de convoitise, une envie d’enfance et de douceur gustative. Les papilles s’activent rappelant à chacun que la Foire du Trône n’est pas loin, détournant l’esprit des passagers de leur préoccupation pour leur imposer l’image de stands où les guimauves torsadées tentent de faire de l’ombre à l’aérienne Barbe à papa, les gaufres aux petits carrés nappés de confiture tentent de supplanter les glaces italiennes hélicoïdales. Ma main part subrepticement à la recherche d’un quelconque bonbon oublié dans mon sac…
Dimanche. Saint-Michel. Sept heures du matin, j’attends le prochain métro pour aller courir dans un des parcs de la capitale. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le train arrive et m’invite à monter dans un claquement de portes coulissantes. La pointe de ma basket touche le sol du wagon, mais je suis arrêtée dans mon élan. Pétrifiés par un relent de soirée mal terminée, mes muscles se refusent à la montée. Mon cerveau mis en alerte analyse à vitesse grand V les composantes primaires de cette pestilence : mélange âcre de sucs gastriques, d’aliments semi-digérés et de bière. Ses déductions me propulsent sur le quai. Je décide : aujourd’hui, j’irai à pied. Je flairerai les senteurs et relents de la rue…