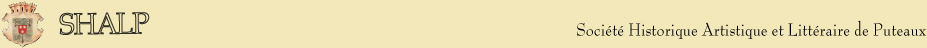
Saga des Gramont à Puteaux :
« Introduction »
Par Jean-François Martre
Jean Ritter est l'historien de cette prestigieuse famille dont il a raconté l'histoire depuis l'an 1040 jusqu'à
l'an 1967, avec Jean de Jaurgain, dans les deux tomes de La Maison de Gramont publiés par Les amis
du musée pyrénéen en 1968.
Ces deux tomes sont la source principale des nombreux épisodes qui croisant l'histoire de notre commune sur
trois siècles font l'objet de cette saga des Gramont à Puteaux.
Le Duc de Mirepoix, de l'Académie Française, en fait la préface, merveilleuse introduction à cette longue
histoire de famille qui mérite d'être citée entièrement.
« Continuer c'est revivre.
Une famille qui dure, c'est une famille qui recommence. Que de fois n'a-t-on pas vu de ces êtres foudroyants
traverser un coin d'histoire, l'éblouir et disparaître sans laisser de trace. Qu'est devenue cette force
acquise ? Qui l'a recueillie ? personne.
N'est-il pas plus difficile d'être un continuateur qu'un fondateur ? Le fondateur peut avoir quelque occasion
providentielle et delà, bondir. Un continuateur aussi, peut-être. Mais leur suite ne pourra faire surface si
l'effort ne renouvelle pas l'impulsion première. Il y a donc un mérite rare, à la fois collectif et personnel,
pour une suite d'êtres humains, à tenir. Une telle action constante s'appelle en définitive une race.
L'histoire des Gramont en donne un éclatant exemple. Cette vaste épopée qui les raconte, aboutissement de si
longues années de travail, n'a pas besoin de préface, sinon par témoignage d'amitié, amitié pour les descendants
de ceux qui ont parcouru ce chemin séculaire, amitié pour son historien principal qui a promené sa lampe parmi
tant de nobles ombres.
Or, en 1936, disposant d'un éditorial dans LE JOUR de Léon Bailby, j'avais salué un livre de Raymond Ritter,
portant la marque d'un historien parmi les meilleurs. Il s'agissait justement d'un épisode Gramont. Ce livre
que tout le monde connaît s'intitulait Cette Grande Corisande.
Il ne contait pas seulement l'un des plus beaux romans d'amour de l'histoire. Il touchait à la politique du
royaume, dont il révélait l'un des plus étonnants secrets.
Le terme de favorite ne convient en aucune manière à la fière et indépendante Diane d'Andoins (1554-1621, épouse
de Philibert de Gramont, Comte de Guiche qui fut un des mignons du Roi) dont nous tenons à honneur qu'elle ait
eu pour aïeule une Lévis-Mirepoix. Éprise de romans de chevalerie, elle changea son prénom en celui de Corisande
et le porta comme une amazone ! A cette époque où Henri IV, qui avait horreur de la guerre civile, se battait
comme chef de parti dans une lutte harassante, Corisande apparut comme l'inspiratrice du sauveur de la France.
La passion du Béarnais, loin de lui faire oublier ce qu'il était, lui révéla ce qu'il pouvait être.
Or voici ce qu'il arriva. La mort du Duc d'Anjou (François frère du roi, meurt de tuberculose en 1584)) venait
de faire d'Henri l'héritier du trône. Mais la Ligue s'opposait à lui et paralysait Henri III (1551-1589), c'est
le dernier des Valois, (il meurt assassiné au château de Saint-Cloud). L'armée du
duc de Joyeuse fut envoyée contre le Béarnais. Il devait à ses partisans un morceau de bravoure. Il le leur
donna en écrasant Joyeuse à Coutras (20 octobre 1587). Ceux-ci s'attendaient à ce que, profitant du triomphe,
leur chef se jetât sur les autres armées royales.
Il n'en fut rien. Henri licencia ses troupes, et, au grand scandale d'Agrippa d'Aubigné, fit mine d'aller en
Béarn porter les étendards conquis aux pieds de Corisande.
La feinte était si habile que bon nombre d'historiens, jusqu'au vingtième siècle, l'attribuèrent aux exigences
d'une « dame » et à la légèreté d'un Roi trop amoureux. L'intolérance, le fanatisme des deux partis empêchaient
d'agir au grand jour pour rechercher la paix.
Le Béarnais n'a qu'une pensée après Coutras, se rapprocher d'Henri III, l'assurer que, s'il a battu la Ligue, il
a servi son roi en le débarrassant d'un obstacle, placé par tant d'intrigues, entre le souverain régnant et son
héritier. Henri, toujours si rapide, interrompt sa marche vers le Béarn. Il marque une longue étape chez
Montaigne. Et Corisande a compris : Montaigne, l'écrivain universel et soi-disant égoïste - en réalité ami
dévoué des deux princes- sera l'ambassadeur secret entre le roi de Navarre et le roi de France.
Quand il eut vu l'escorte de son hôte royal, Montaigne fit charger son bagage sur ses mulets de bât. Où
allait-il ? A Paris, affligé de sa lancinante gravelle, à travers les fondrières des routes, le brigandage, le
flux et le reflux des combats.
Don Bernardino de Mendoza, ambassadeur très informé de S.M. Catholique ne s'y trompait pas quand, après avoir
attiré, dès le 25 février 1588, l'attention de son maître sur le caractère mystérieux de la venue de Montaigne à
la cour, il écrivait :
Monsieur de Montaigne est tenu pour un homme intelligent, encore qu'un peu brouillon. On me dit qu'il gouverne
la Comtesse de Guiche (Corisande), dame de grande beauté qui vit chez la sour du Béarnais ! D'où l'on déduit
qu'il vient accomplir quelque mission. de concert avec ladite Comtesse de Guiche .
La découverte de notre historien ne s'appuie pas seulement sur ce texte de l'ambassadeur espagnol, elle est
confirmée par une lettre de Duplessis Mornay, principal conseiller du roi de Navarre, écrite à sa femme à
Montauban :
Monsieur de Montaigne est allé en cour. On nous dit que nous serons bientôt recherchés de paix par personnes
neutres.
Ces textes, rapprochés de la visite après Coutras, ne sauraient laisser le doute sur l'objet du voyage de
Montaigne.
Nous avons par cet épisode, saisi, pour ainsi dire, en plein développement, l'Histoire des Gramont.
Ils occupaient alors, depuis plusieurs siècles, des positions considérables dans le royaume. Il ne tenait qu'au
fils de Corisande, veuve de Philibert de Gramont tué, fort jeune, dans les rangs catholiques au siège de Le
Fère (1580, il avait vingt- huit ans), d'approcher au plus près de la couronne, Henri IV lui avait offert de le
reconnaître, alors que, de notoriété publique, il était né plusieurs années avant l'illustre idylle. Antonin de
Gramont ne voulut pas de ce lien fictif et préféra devoir à ses services le beau duché militaire qui s'est
perpétué dans sa lignée. Il a bataillé, et rudement bataillé, toute sa vie au service du roi.
Hors ce dévouement absolu, c'était un caractère sombre et impitoyable qui fit juger et exécuter, pour infidélité
, sa femme sur son territoire souverain de Bidache. On croit reconnaître dans une nouvelle de Balzac, les traits
de ce farouche guerrier. Ce n'est pas le seul des Gramont que l'on rencontre dans le roman et sur le théâtre,
preuve que leurs caractères avaient de quoi retenir l'attention des observateurs du cour humain.
Reprenons-les de plus haut, quand les Capétiens viennent de monter sur le trône. Ces gascons surgissent aux
confins sud du royaume et prennent part à ce qu'on pourrait appeler les oscillations frontalières de la France.
Du côté des Pyrénées le vent souffle entre les royaumes espagnols et les avancées du roi de Paris. Du côté de
l'Océan, le Capétien se voit pressé par son rival Plantagenet, duc de Guyenne.
L'arbre des Gramont va pousser dans ces orages et la bourrasque le fera pencher tour à tour vers un de ces
grands fiefs.
C'est ici qu'il faut donner à la féodalité tout son sens réaliste et constructif. Ce mot a été complètement
déformé par le langage moderne. Aujourd'hui, féodalité signifie accaparement. Alors, il signifiait engagement
réciproque. Un réseau compliqué de contrats se tissait. Cette hiérarchie ou quelque fois cet entrecroisement
contenait, en soi-même, une garantie, du fait que plus haut était le suzerain, plus il n'était fort que du
nombre de ses vassaux. Mais tout le système, à la fois instinctif et d'une savante complexité, reposait sur la
terre.
Que cherchent les Gramont ? S'appuyer sur des assises territoriales. Ils vont se donner trois principaux points
d'appui qu'ils maintiendront au cours des siècles : Gramont, Bidache et une grande ville sur l'Adour : Bayonne.
A Bidache, les visites royales étaient de splendeur coutumière.
Entre eux et leurs hommes s'établira une confiance rude, parfois heurtée, mais en somme fidèle et hautement
revendiquée de part et d'autre jusqu'à la fin de la monarchie.
Envers la couronne comment s'étonner de voir ces Gramont transporter leur hommage des rois de Navarre aux rois
d'Angleterre, ducs de Guyenne ou, de ceux-ci au roi de France ? Tout le sud de l'hexagone oscille comme eux,
cherchant sa voie. Mais, dès le XIIIe siècle, le grand baron Arnaud Guillaume de Gramont compte parmi les forces
dont les princes cherchent, tour à tour, la chute ou l'appui. Cette quête du destin est du plus haut intérêt
pour l'Histoire générale.
Cela ne se fait pas sans heurts, sans violence, sans défis. On verra, sur la place d'armes du château de
Pampelune un duel judiciaire présidé par Charles le Mauvais, entre Arnaud Raymond de Gramont et Ramirez Sanchez
d'Asiain. Mais la parenté se précipite entre les combattants et interrompt le combat. Il n'en sera pas toujours
ainsi. Les Gramont paieront une large contribution aux duels mortels.
Toutefois un curieux arrangement s'établit de leur part. S'il y a un différend entre le roi d'Angleterre et le
roi de Navarre : les terres que Gramont tient de l'un ou de l'autre serviront le souverain dont elles dépendent.
On voit ici la terre féodale revêtir toute la complexité d'un échiquier.
Pendant la guerre de Cent Ans, les Gramont, comme tous les Gascons, auront un choix difficile entre le souverain
immédiat, le duc d'Aquitaine, roi d'Angleterre, et leur souverain éminent, le roi de France. Mais ils ont le
sens politique. En définitive, ils écoutent l'appel de Gaston IV, comte de Foix, qui les amène à Charles VII.
La lignée servira la monarchie française de toute son influence en Navarre. Le Cardinal de Gramont, archevêque
de Toulouse, négociera le mariage d'Henri, alors duc d'Orléans et futur Henri II avec Catherine de Médicis.
Toute la parenté du prélat ne cessera de recevoir de la reine des témoignages de sa bienveillance.
(D'après René Sordes, Société d'Histoire de Suresnes, le Cardinal Gabriel de Gramont est prévôt commanditaire
ayant bénéficié des revenus de la seigneurie de Suresnes en 1522. Ce serait la première relation d'un Gramont
avec Suresnes et Puteaux).
Voici qu'après l'oscillation frontalière, vient l'oscillation religieuse. Elle sera de courte durée.
Antoine 1er, après avoir été un des chefs de la Réforme, va tirer, avec une habileté consommée, des vicissitudes
territoriales de sa famille, une des conclusions les plus originales. Profitant des controverses de vassalité
qui ont tenu, pendant plusieurs siècles, son fief de Bidache entre plusieurs suzerainetés royales, il réussit à
l'affirmer terre souveraine, sans opposition formelle de la couronne. L'on retrouve ici la gratitude de
Catherine de Médicis envers le souvenir du Cardinal de Gramont.
Cette situation, établie de fait, devait traîner en discussions jusqu'à un arrêt favorable du Conseil de
Régence en 1716.
Une nouvelle occasion se présenta pendant la Fronde de reprendre les hésitations anciennes à l'égard du pouvoir.
Antoine III, premier Maréchal de Gramont, ne balança jamais entre la Fronde et le service du roi, bien qu'il fût
lié de grande amitié avec le Prince de Condé et sans que leur attachement réciproque en souffrit jamais.
Désormais toutes les destinées des Gramont s'orienteront autour de la couronne. Mais ils garderont des traits de
caractères qui les préserveront de l'uniformité.
Tel le comte de Guiche, amoureux désespéré d'Henriette d'Angleterre, Duchesse d'Orléans, popularisé par Alexandre
Dumas (dans les Trois Mousquetaires), comme un autre Gramont le sera plus tard, dans le roman d'Hamilton son
beau-frère. Mais les véritables aventures de ces existences dépassent de beaucoup celles que leur a prêtées le
roman.
Ils feront mieux que de traverser l'Histoire. Ils y participeront.
Voici Antoine Charles de Gramont, Antoine IV, jouant de finesse à Madrid avec la Princesse des Ursins (en 1704).
La correspondance qu'il entretint avec cette femme extraordinaire, aussi bien qu'à propos d'elle, avec la cour
de France, affirme, dans un style des plus fins, ses dons, d'humaniste et d'observateur politique.
Voilà sur le champ de bataille de Fontenoy (11 mai 1745), Louis, duc de Gramont qui, souffrant cruellement de la
goutte, se fait porter sur une litière à la tête de son régiment jusqu'à ce qu'il soit frappé à mort.
Aux approches de la Révolution, on les verra, tantôt près du roi, face à l'émeute des 5 et 6 octobre, tantôt
retournant vers leur terre d'origine, au milieu des troubles qui grondent, et suscitant cet inépuisable élan
d'affection, où l'auteur de ce livre décèle tout ce qui restait encore d'anciennes forces vives dans une
compréhension réciproque trop négligée, au crépuscule de la vieille France.
Les Gramont qu'on retrouve à la Moskowa, ont continué à se battre dans les armées de Napoléon 1er et ont donné à
Napoléon III un diplomate dont la jeunesse, brillante et charmeuse, forme un contraste saisissant avec le rôle
de ministre des Affaires étrangères, au moment où le second Empire fut jeté dans la catastrophe, qu'en dépit des
commentaires les plus cruels, Antoine Agénor de Gramont avait tout fait pour éviter. »
Sachez que dans cette histoire de famille passionnante, on rencontre aussi la très célèbre Élaine Greffulhe qui
épouse en seconde-noce, en 1904 Armand de Gramont (1879-1962) à la Madeleine et devient duchesse de Guiche.
Armand est un grand scientifique qui créé la société OPL « Optique et Précision de Levallois ». Quant à son
père, Antoine Agénor dont le duc de Mirepoix vient de nous parler, il avait épousé Marguerite de Rothschild qui
était tombée amoureuse de ce jeune duc de Guiche et refusa d'épouser son cousin le baron Edmond de Rothschild
que son père avait prévu de lui donner pour mari, devenant ainsi duchesse de Gramont.
J.F.M. - 03/2022