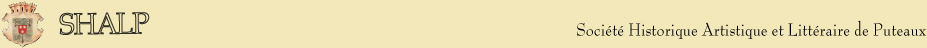
Coucher de soleil
par Jean- François Martre
Coucher de soleil avec la pompe Wallace et les terrasses de Bagatelle, par Pinckney Marcius-Simons

Photo catalogue de vente Artcurial du 11 février 2025
Cette scène familière de nos promenades au Bois de Boulogne mérite bien une petite enquête sur l'auteur, la datation de
l'œuvre qui n'est pas donnée, le titre ambigu et la mise en scène proposée qui n'a pas l'exactitude d'une
photographie.
Que sait-on de Pinckney Marcius-Simons (1867-17 juillet 1909) ?
L'article de Wikipédia à son sujet nous apprend beaucoup de choses.
Il est né en 1867 à New-York, passe sa jeunesse en Espagne, Italie et poursuit ses études académiques au collège des
jésuites de la rue Vaugirard à Paris. Remarqué par Edouard Detaille, celui-ci le pousse à conduire en parallèle à ses
études, une formation artistique en rentrant comme élève de Vibert. Lorsque ce dernier fermera son atelier, Pinckney
sera accueilli comme un membre de sa famille.
Il signe dès 16 ans des tableaux académiques dont celui qui nous intéresse fait certainement partie.

Sarah Bernhardt en La Tosca, œuvre de 1887 ou 1888
Les premiers salons dans lesquels il présente ses œuvres académiques sont à Paris et Londres en 1892.
Après 1892, il change complètement de style, sans doute à la suite d'une grave maladie. Son inspiration peut être alors
classée de symbolique empruntant des visions religieuses au catholicisme, des éléments de la mythologie classique, et
des thèmes des opéras de Richard Wagner. Jusqu'à la fin de sa vie, c'est un bayreuthien fervent, fidèle du festival que
dirige alors Cosima Wagner et son fils Siegfried.

Parsifal et les chevaliers du Saint Graal daté 1904.
De santé délicate, il meurt à quarante-deux ans à Bayreuth où il est enterré.
Il est nommé chevalier de la Légion d'Honneur en 1908.
Qui étaient les propriétaires de Bagatelle à cette époque ?
Richard Wallace est propriétaire du domaine depuis 1870, mais il vit en reclus depuis la mort de son fils en 1887 et
meurt le 20 juillet 1890. Cet amateur de tableaux peut avoir invité des peintres du temps de son vivant.
Il lègue ses biens à sa femme Julie Castelnau (1819-1897). Elle n'est pas restée à Bagatelle, mais de son temps le domaine était bien entretenu par un jardinier en chef et une trentaine d'ouvriers comme l'écrit Pauline de Broglie qui avait le privilège d'y entrer librement avec les Greffulhe et les d'Arenberg. Marcius-Simons y a-t-il eu accès ?
Julie Castelnau cède à son décès les collections et biens anglais à l'Angleterre et Bagatelle à son secrétaire et homme de confiance John Murray Scott. Ce dernier vide le château et le parc de tout le mobilier et de la plupart des statues, mais ne peut réussir à lotir le parc qui est racheté par la ville de Paris en 1905.
Le parc est alors réhabilité par Nicolas Forestier, conservateur du Bois de Boulogne, et réouvert au public. La partie roseraie sera correctement entretenue jusqu'à nos jours.
Le 15 mars 1907, Charles Voisin y accomplit le premier vol mécanique sur un avion à moteur à explosion, un V8 « Antoinette » de la société éponyme de Levavasseur à Puteaux.
Malheureusement, le château ne cessera de se dégrader jusqu'à l'arrivée de Jacqueline Nebout en 1977 qui lance sa restauration intérieure et extérieure.
A quel moment Pinckney Marcius-Simons a-t-il peint ce tableau ?
Ce tableau n'est pas daté par la maison de vente.
Par sa facture académique, il est très probable qu'il soit d'avant 1892, début de sa période symbolique.
Mais, il est aussi possible qu'il ait eu accès, comme Pauline de Broglie, au parc du temps de Julie Castelnau.
On peut penser qu'après 1897 cette partie du parc avait un aspect d'abandon que ne reflète pas notre tableau.
Ambiguïté dans le titre du tableau - La pompe à feu Wallace


Nous ne savons pas qui a donné ce nom à ce tableau.
Dans cette vente, on désigne la pompe à feu « pompe Wallace ».
Comme on va le voir, cette pompe à feu installée au bord de l'allée du Bord-de-l 'Eau a été construite pour lord Seymour,
marquis d'Hertford et non pour Richard Wallace son fils présumé.
En 1783, le comte d'Artois (futur Charles X) décide d'installer une pompe à feu pour permettre l'irrigation des terrains
de sa ferme ainsi que l'alimentation des pièces d'eau de son château de Bagatelle. Elle fonctionnera jusqu'en 1860. A
cette date, les travaux d'aménagement du Bois de Boulogne battent leur plein. En remplacement de l'antique machine, Lord
Seymour, marquis d'Hertford, fait construire par Léon de Sanges cet élégant pavillon équipé d'une moderne chaudière à
condensation chauffée au coke. Partie intégrante du domaine de Bagatelle, ce pavillon appartient à la ville de Paris
depuis 1905.

Source : Henri Corbel, Petite Histoire du Bois de Boulogne, Albin Michel.
Vues aériennes


2012 - chassimage.com IGN. Remonter le temps - 1919
Léon de Sanges, né François Léon Desanges
Né le 17/12/1819 à Paris 3e, mort le 28/08/1879 à Vermenton (Yonne)
Il devient architecte en 1850 et prend le nom de de Sanges.
Au début, il travaille beaucoup pour Lord Seymour, marquis d'Hertford puis, après la mort de ce dernier, il continue avec son fils Richard Wallace :
1853, immeuble au 29 boulevard des Italiens pour Lord Seymour
1860, pompe à feu du Bois de Boulogne pour lord Seymour
1872 Remaniement du château de bagatelle (ajout d'un étage, démolition de bâtiments annexeS, remaniement de la cour
enserrée par des terrasses, construction du trianon et de nouveaux pavillons d'entrée pour Richard Wallace.
1878 Il épouse à Paris Léonide Élisabeth Pauline Carly de Svazzema qui décèdera le 14 juillet 1926 à Puteaux (acte de
décès n° 352)., où elle habitait 7 rue des Pavillons.

En conclusion, cette pompe à feu est celle de lord Seymour et non celle de Richard Wallace
Que sont devenus les différentes pièces du décor de ce tableau ?
Nous avons longuement parlé de la pompe à feu.
La terrasse ouest est construite en 1872
Lord Hertford meurt à Bagatelle le 25 août 1870.
Richard Wallace, son fils supposé, en hérite et fait exécuter d'importants travaux d'agrandissement et de surélévation
du château, ainsi que le réaménagement de la cour d'honneur, encadrée de deux terrasses, l'une à l'ouest tournée vers la
Seine, l'ile de Puteaux et le mont Valérien, l'autre à l'est longe un nouveau bâtiment, le trianon de Bagatelle.

La terrasse de l'ouest avec l'escalier et les deux sphinges, bordée d'une balustrade en fer forgé. Si vous fréquentez les jardins de Bagatelles, vous n'êtes pas surpris de la présence de ces deux chats. En fait, il y en a partout. Cela date-t-il de cette époque ?

Photo 2024, JFM - L'escalier


Photo 2024, JFM La sphinge Photo 2024, JFM, la balustrade
L'escalier est le même avec ses dix marches, les sphinges ont perdu l'angelot de bronze qui les chevauchait, la balustrade a gardé son dessin.
Les sphinges de Bagatelle et leurs angelots


Le tableau Escalier principal avant 1963


Terrasse ouest sans les angelots Escalier rotonde nord
Tous les escaliers étaient ornés de sphinges chevauchées d'angelots, comme sur le tableau. Les angelots ne sont plus là. On n'a pas de trace de ceux des deux terrasses qui ont été construites en 1872. Cependant on a une photo datée d'avant 1963 de ceux qui se trouvaient sur les sphinges devant l'entrée du château et qui datent de la folie d'Artois 1781. Depuis, ils ont été volés. Au nord, face au jardin à la française se trouvent deux magnifiques chevauchées de deux amours en marbre. Ce beau visage serait celui de Rosalie (Rose) Duthé (1748 - 1830) courtisane sous Louis XV qui fut modèle de nombreux peintres et sculpteurs.
La cheminée d'usine à Puteaux
La cheminée d'usine que l'on voit dans une trouée est très certainement la cheminée de l'Atelier de construction de Puteaux (ATX) dit l'Arsenal qui est une des premières usines de la banlieue parisienne, construite en 1866.
L'aperçu de Puteaux qui nous est offert est encore bucolique avec des maisons et des toits en tuiles, une ligne de crête sans construction.
Dans cet axe de vue, après 1900, on devrait trouver les deux cheminées jumelles de l'usine d'électricité Ouest lumière, fondée en 1900 et peu après celle de l'usine Unic fondée en 1905.
Ce tableau a dû être peint avant 1900.

Cette silhouette en contre-jour est une image fidèle de la forteresse avec à droite le fortin qui abritait le canon de marine La Valérie.

La prise de vue et la mise en scène

Le chevalet du peintre est probablement installé sur la terrasse du trianon de Bagatelle à droite de la photo ce qui lui
permet de mettre en valeur le mont Valérien et la crête de la colline de Chantecoq, et d'apercevoir la Seine en contrebas.
Cependant il se permet une petite distorsion en plaçant le mont Valérien dans l'axe de l'escalier et en déplaçant vers la
droite la pompe à feu.
Dans la réalité (voir photo 2024), c'est la pompe à feu qui est dans l'axe et le mont Valérien se retrouve alors à gauche
de l'image.


Ce coucher de soleil de Marcius-Simons nous a permis de revisiter la cour d'honneur du château de Bagatelle et
particulièrement cette terrasse tournée vers l'ouest où on s'installait en été sur des chaises longues pour regarder, tout
en caressant les chats familiers, le soleil se coucher derrière la crête de Chantecoq. Dans ces années, autour de 1890, la
vue était encore bucolique, et on s'était habitué à la première cheminée d'usine qu'on voyait à peine derrière les arbres de
l'ile de Puteaux.
Éclairé par le soleil levant, le fort du Mont Valérien se découpait en contre-jour au moment du couchant en une silhouette
menaçante qui devait rappeler des souvenirs terribles au propriétaire des lieux, Richard Wallace, qui avait assisté au
bombardement de Neuilly et des défenses parisiennes en 1870.
La pompe à feu de Lord Seymour décalée au nord dans la mise en scène du peintre reçoit les derniers rayons de soleil qui
la mettent en valeur sur la ligne sombre des arbres de l'ile. Elle fonctionne encore et alimente les étangs du domaine et
l'arrosage des parcs et plantations.
Elle est aujourd'hui dans un triste état d'abandon et ne fonctionne plus, ses circuits de distribution d'eau vers le parc
sont coupés. Ne pourrait-on imaginer de recréer un lien entre le parc et la pompe qui la sortirait de son isolement et
lui redonnerait toute sa place comme sur le tableau ?
J.R 01/2025